Vos poèmes préférés
+113
So Sûre 2
Confiteor
pili
Archiloque
paຮލຮage
Kafka
Basilice
MoojiKadja
espérance
aveugle et sans âme
isadora
Enaid
St'ban
LhaleeTreize
SparklingLance
KarlShuge
Une fille bleue de l'été
Sarty
Mahé
Manawydan
Patate
Ombrinou
Sabrilanuit
Sapta
Tokamak
Suzanne Smith
Cérès
Clémence
bapt64
Thybo
Carquand
chaton-pitbull
Fluegel
mypseudo
Petite Perle Givrée
Clausule
Umbria
Néfertiti
Manubaliste
Cedrina
Mika2
Gianpao
poupée BB
Nochéry
IndianaJoan
Kodiak
Subrisio Saltat.
Tan
zebravalia
ou-est-la-question
CindyJo
Bacha Posh
Zwischending
Plume88
Chat Bleu
lyra22
Adikia
Princeton
Soren
iridium
Aristippe
Fata Morgana
une (gaufre)
SeaTurtle
Harpo
albatrosdore
Amelia Pond
Killian
Elther
david50
Icare
Super Sheldandy de l'ACS
Banquo
UK09
Cypher
Bouclette
Ainaelin
Kalimsha
j0hn
Olifaxe
dessein
laDivine
ΣΦ
nails
Bird
Pieyre
l'albatros
lilou1984
Thaïti Bob
kim meyrink
Pyrrhon
Belo-Horizonte
Laetitia
MaxenceL
AlsoSpratchAlmaMater
Benjamin
FunkyKyu
Melsophos
Elfelune
Christine
L.Lune
didimj
miwako
Lokidor
sabatchka
Maly
ahlala
Plaisance14
Lanza
WaterShed
lynka
Phedre
Cerra Top
117 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
et merci Alphonsine pour l'index
ou-est-la-question- Messages : 8075
Date d'inscription : 27/07/2012
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
https://www.facebook.com/pages/Amis-des-Editions-Al-Manar/469234970034?fref=nf
Le Festival "Voix Vives de la Méditerranée" bat son plein à Sète. Il est encore temps de nos rejoindre ! Jusqu'à la fin de cette semaine, la poésie sera partout dans cette cité dionysiaque…!
Le Festival "Voix Vives de la Méditerranée" bat son plein à Sète. Il est encore temps de nos rejoindre ! Jusqu'à la fin de cette semaine, la poésie sera partout dans cette cité dionysiaque…!

zebravalia- Messages : 685
Date d'inscription : 10/01/2014
Age : 55
Localisation : maroc
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Un peu de Paul-Jean Toulet, qui correspond bien à mon humeur un peu mélancolique, ce soir.
Décor d’encre. Sur le ciel terne
Court un fil de fer :
Mansarde où l’on aima, vanterne
Sans carreaux, où l’on a souffert.
Une enfant fait le pied de grue
Le long du trottoir.
Le bistro, du bout de la rue,
Ouvre un oeil de sang dans le noir ;
Tandis qu’on pense à sa province,
A Faustine, à Zo’…
Mais c’est pour Lilith que j’en pince :
Autres chansons, autres oiseaux.
Quelques fois
Quelquefois, après des ébats polis,
J'agitai si bien, sur la couche en déroute,
Le crincrin de la blague et le sistre du doute
Que les bras t'en tombaient du lit.
Après ça, tu marchais, tu marchais quand même ;
Et ces airs, hélas, de doux chien battu,
C'est à vous dégoûter d'être tendre, vois-tu,
De taper sur les gens qu'on aime.
Soir de Montmartre
Décor d’encre. Sur le ciel terne
Court un fil de fer :
Mansarde où l’on aima, vanterne
Sans carreaux, où l’on a souffert.
Une enfant fait le pied de grue
Le long du trottoir.
Le bistro, du bout de la rue,
Ouvre un oeil de sang dans le noir ;
Tandis qu’on pense à sa province,
A Faustine, à Zo’…
Mais c’est pour Lilith que j’en pince :
Autres chansons, autres oiseaux.
Quelques fois
Quelquefois, après des ébats polis,
J'agitai si bien, sur la couche en déroute,
Le crincrin de la blague et le sistre du doute
Que les bras t'en tombaient du lit.
Après ça, tu marchais, tu marchais quand même ;
Et ces airs, hélas, de doux chien battu,
C'est à vous dégoûter d'être tendre, vois-tu,
De taper sur les gens qu'on aime.
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Un homme passe sous la fenêtre et chante.
Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux
Comme la vitre pour le givre
Et les vêpres pour les aveux
Comme la grive pour être ivre
Le printemps pour être amoureux
Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux
Toi qui avais des bras des rêves
Le sang rapide et soleilleux
Au joli mois des primevères
Où pleurer même est merveilleux
Tu courais des chansons aux lèvres
Aimé du Diable et du Bon Dieu
Toi qui avais des bras des rêves
Le sang rapide et soleilleux
Ma folle ma belle et ma douce
Qui avais la beauté du feu
La douceur de l’eau dans ta bouche
De l’or pour rien dans tes cheveux
Qu’as-tu fait de ta bouche rouge
Des baisers pour le jour qu’il pleut
Ma folle ma belle et ma douce
Qui avais la beauté du feu
Le temps qui passe passe passe
Avec sa corde fait des nœuds
Autour de ceux-là qui s’embrassent
Sans le voir tourner autour d’eux
Il marque leur front d’un sarcasme
Il éteint leurs yeux lumineux
Le temps qui passe passe passe
Avec sa corde fait des nœuds
On n’a tiré de sa jeunesse
Que ce qu’on peut et c’est bien peu
Si c’est ma faute eh bien qu’on laisse
Ma mise à celui qui dit mieux
Mais pourquoi faut-il qu’on s’y blesse
Qui a donc tué l’oiseau bleu
On n’a tiré de sa jeunesse
Que ce qu’on peut et c’est bien peu
Tout mal faut-il qu’on en accuse
L’âge qui vient le cœur plus vieux
Et ce n’est pas l’amour qui s’use
Quand le plaisir a dit adieu
Le soleil jamais ne refuse
La prière que font les yeux
Tout mal faut-il qu’on en accuse
L’âge qui vient le cœur plus vieux
Et si ce n’est pas nous la faute
Montrez-moi les meneurs du jeu
Ce que le ciel donne qui l’ôte
Qui reprend ce qui vient des cieux
Messieurs c’est ma faute ou la vôtre
A qui c’est-il avantageux
Et si ce n’est pas nous la faute
Montrez-moi les meneurs du jeu
Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux
Le monde l’est lui pour y vivre
Et tout le reste est de l’hébreu
Vos lois vos règles et vos bibles
Et la charrue avant les bœufs
Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux.
Louis Aragon – Elsa – 1959
Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux
Comme la vitre pour le givre
Et les vêpres pour les aveux
Comme la grive pour être ivre
Le printemps pour être amoureux
Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux
Toi qui avais des bras des rêves
Le sang rapide et soleilleux
Au joli mois des primevères
Où pleurer même est merveilleux
Tu courais des chansons aux lèvres
Aimé du Diable et du Bon Dieu
Toi qui avais des bras des rêves
Le sang rapide et soleilleux
Ma folle ma belle et ma douce
Qui avais la beauté du feu
La douceur de l’eau dans ta bouche
De l’or pour rien dans tes cheveux
Qu’as-tu fait de ta bouche rouge
Des baisers pour le jour qu’il pleut
Ma folle ma belle et ma douce
Qui avais la beauté du feu
Le temps qui passe passe passe
Avec sa corde fait des nœuds
Autour de ceux-là qui s’embrassent
Sans le voir tourner autour d’eux
Il marque leur front d’un sarcasme
Il éteint leurs yeux lumineux
Le temps qui passe passe passe
Avec sa corde fait des nœuds
On n’a tiré de sa jeunesse
Que ce qu’on peut et c’est bien peu
Si c’est ma faute eh bien qu’on laisse
Ma mise à celui qui dit mieux
Mais pourquoi faut-il qu’on s’y blesse
Qui a donc tué l’oiseau bleu
On n’a tiré de sa jeunesse
Que ce qu’on peut et c’est bien peu
Tout mal faut-il qu’on en accuse
L’âge qui vient le cœur plus vieux
Et ce n’est pas l’amour qui s’use
Quand le plaisir a dit adieu
Le soleil jamais ne refuse
La prière que font les yeux
Tout mal faut-il qu’on en accuse
L’âge qui vient le cœur plus vieux
Et si ce n’est pas nous la faute
Montrez-moi les meneurs du jeu
Ce que le ciel donne qui l’ôte
Qui reprend ce qui vient des cieux
Messieurs c’est ma faute ou la vôtre
A qui c’est-il avantageux
Et si ce n’est pas nous la faute
Montrez-moi les meneurs du jeu
Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux
Le monde l’est lui pour y vivre
Et tout le reste est de l’hébreu
Vos lois vos règles et vos bibles
Et la charrue avant les bœufs
Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux.
Louis Aragon – Elsa – 1959

Tan- Messages : 101
Date d'inscription : 04/08/2014
Age : 42
Localisation : Paris
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
- La lune blanche
Luit dans les bois;
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée...
Ô bien-aimée.
L’étang reflète,
Profond miroir,
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure...
Rêvons, c’est l’heure.
Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l’astre irise...
C’est l’heure exquise.
— Paul Verlaine
Pieyre- Messages : 20908
Date d'inscription : 17/03/2012
Localisation : Quartier Latin
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Oui, merci. Beaucoup de poèmes ont été mis en chanson, mais c'est d'autant plus difficile quand leurs vers sont courts, me semble-t-il. Il serait intéressant de discuter de la musicalité des poèmes, y compris celle particulière qu'on leur donne en les énonçant.
Et merci pour la mise à jour de l'index.
Et merci pour la mise à jour de l'index.
Pieyre- Messages : 20908
Date d'inscription : 17/03/2012
Localisation : Quartier Latin
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
En effet.
Ma grande interrogation, notamment, a toujours été : comment lit-on le vers libre ? Les règles nous permettent, sinon, de lire "correctement" les vers classiques (et encore, y'a-t-il une façon correcte de lire, et les autres ? J'ai remarqué, par exemple, que la diction des acteurs, pour les pièces en vers, était différente de la façon dont on énonçait les poèmes en littérature), mais qu'en est-il, dès lors qu'on travaille à désaccorder, déséquilibrer le vers... ? Et les vers courts, et les impairs ?
Les règles nous permettent, sinon, de lire "correctement" les vers classiques (et encore, y'a-t-il une façon correcte de lire, et les autres ? J'ai remarqué, par exemple, que la diction des acteurs, pour les pièces en vers, était différente de la façon dont on énonçait les poèmes en littérature), mais qu'en est-il, dès lors qu'on travaille à désaccorder, déséquilibrer le vers... ? Et les vers courts, et les impairs ?
Pour le coup, si j'adore le morceau de Reynaldo Hahn, je trouve qu'il ne met pas particulièrement en valeur le texte - j'ai longtemps écouté cette chanson sans "capter" que c'était un poème de Verlaine ... Aujourd'hui, de le savoir, je l'écoute différemment...
... Aujourd'hui, de le savoir, je l'écoute différemment...
De rien pour l'index, ça me fait plaisir de contribuer ainsi au sujet.
Ma grande interrogation, notamment, a toujours été : comment lit-on le vers libre ?
Pour le coup, si j'adore le morceau de Reynaldo Hahn, je trouve qu'il ne met pas particulièrement en valeur le texte - j'ai longtemps écouté cette chanson sans "capter" que c'était un poème de Verlaine
De rien pour l'index, ça me fait plaisir de contribuer ainsi au sujet.
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Petite mise au vert (sans mauvais jeu de mot...) et plus avec John Keats.
Endymion (Ouverture, 1818)
A thing of beauty is a joy for ever:
Its loveliness increases; it will never
Pass into nothingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.
Therefore, on every morrow, are we wreathing
A flowery band to bind us to the earth,
Spite of despondence, of the inhuman dearth
Of noble natures, of the gloomy days,
Of all the unhealthy and o'er-darkened ways
Made for our searching: yes, in spite of all,
Some shape of beauty moves away the pall
From our dark spirits. Such the sun, the moon,
Trees old and young, sprouting a shady boon
For simple sheep; and such are daffodils
With the green world they live in; and clear rills
That for themselves a cooling covert make
'Gainst the hot season; the mid forest brake,
Rich with a sprinkling of fair musk-rose blooms:
And such too is the grandeur of the dooms
We have imagined for the mighty dead;
All lovely tales that we have heard or read:
An endless fountain of immortal drink,
Pouring unto us from the heaven's brink.
Nor do we merely feel these essences
For one short hour; no, even as the trees
That whisper round a temple become soon
Dear as the temple's self, so does the moon,
The passion poesy, glories infinite,
Haunt us till they become a cheering light
Unto our souls, and bound to us so fast,
That, whether there be shine, or gloom o'ercast,
They alway must be with us, or we die.
............................................................
Un objet de beauté est une joie éternelle
Son charme ne fait que croître; et jamais
Ne sombrera au néant, mais restera toujours
Pour nous un havre de calme, un sommeil
Plein de doux rêves, de santé et d’un calme respire.
Aussi chaque jour qui passe, nous tressons
Une guirlande de fleurs pour nous lier à la terre,
Malgré le désespoir, l’inhumaine disette
De nobles créatures, malgré les jours lugubres,
Les chemins ténébreux et malsains
Où marche notre quête: oui, en dépit de tout,
Une forme de beauté vient enlever le suaire
De nos esprits en deuil. Ainsi font le soleil, la lune,
Les arbres jeunes ou vieux qui offrent leurs première ombres bienfaisantes
Aux humbles brebis; ainsi les jonquilles
Et ce monde verdoyant où elles vivent; et les clairs ruisseaux
Qui se font un couvert de fraîcheur
Contre la brûlante saison; ainsi le fourré au cœur des bois
Richement parsemé de la beauté des roses musquées:
Ainsi pareillement les grandioses destins
Que nous avons imaginés pour les plus grands des morts,
Tous les contes merveilleux, lus ou entendus:
Fontaine intarissable d’un breuvage immortel
Qui coule jusqu’à nous du bord même des cieux
Et ce n’est pas seulement pendant une heure brève
Que ces essences nous pénètrent; non, comme les arbres
Qui bruissent autour d’un temple bientôt deviennent
Aussi précieux que le temple lui-même, ainsi la lune
La poésie – cette passion – gloires infinies
Nous hantent jusqu’à devenir une lumière de réconfort
Pour nos âmes et s’attacher à nous d’un lien si puissant
Que, dans le soleil ou sous un ciel couvert et sombre,
Il nous faut toujours les garder près de nous – ou mourir.
(traduction de Jean Briat)
Endymion (Ouverture, 1818)
A thing of beauty is a joy for ever:
Its loveliness increases; it will never
Pass into nothingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.
Therefore, on every morrow, are we wreathing
A flowery band to bind us to the earth,
Spite of despondence, of the inhuman dearth
Of noble natures, of the gloomy days,
Of all the unhealthy and o'er-darkened ways
Made for our searching: yes, in spite of all,
Some shape of beauty moves away the pall
From our dark spirits. Such the sun, the moon,
Trees old and young, sprouting a shady boon
For simple sheep; and such are daffodils
With the green world they live in; and clear rills
That for themselves a cooling covert make
'Gainst the hot season; the mid forest brake,
Rich with a sprinkling of fair musk-rose blooms:
And such too is the grandeur of the dooms
We have imagined for the mighty dead;
All lovely tales that we have heard or read:
An endless fountain of immortal drink,
Pouring unto us from the heaven's brink.
Nor do we merely feel these essences
For one short hour; no, even as the trees
That whisper round a temple become soon
Dear as the temple's self, so does the moon,
The passion poesy, glories infinite,
Haunt us till they become a cheering light
Unto our souls, and bound to us so fast,
That, whether there be shine, or gloom o'ercast,
They alway must be with us, or we die.
............................................................
Un objet de beauté est une joie éternelle
Son charme ne fait que croître; et jamais
Ne sombrera au néant, mais restera toujours
Pour nous un havre de calme, un sommeil
Plein de doux rêves, de santé et d’un calme respire.
Aussi chaque jour qui passe, nous tressons
Une guirlande de fleurs pour nous lier à la terre,
Malgré le désespoir, l’inhumaine disette
De nobles créatures, malgré les jours lugubres,
Les chemins ténébreux et malsains
Où marche notre quête: oui, en dépit de tout,
Une forme de beauté vient enlever le suaire
De nos esprits en deuil. Ainsi font le soleil, la lune,
Les arbres jeunes ou vieux qui offrent leurs première ombres bienfaisantes
Aux humbles brebis; ainsi les jonquilles
Et ce monde verdoyant où elles vivent; et les clairs ruisseaux
Qui se font un couvert de fraîcheur
Contre la brûlante saison; ainsi le fourré au cœur des bois
Richement parsemé de la beauté des roses musquées:
Ainsi pareillement les grandioses destins
Que nous avons imaginés pour les plus grands des morts,
Tous les contes merveilleux, lus ou entendus:
Fontaine intarissable d’un breuvage immortel
Qui coule jusqu’à nous du bord même des cieux
Et ce n’est pas seulement pendant une heure brève
Que ces essences nous pénètrent; non, comme les arbres
Qui bruissent autour d’un temple bientôt deviennent
Aussi précieux que le temple lui-même, ainsi la lune
La poésie – cette passion – gloires infinies
Nous hantent jusqu’à devenir une lumière de réconfort
Pour nos âmes et s’attacher à nous d’un lien si puissant
Que, dans le soleil ou sous un ciel couvert et sombre,
Il nous faut toujours les garder près de nous – ou mourir.
(traduction de Jean Briat)

Killian- Messages : 86
Date d'inscription : 27/02/2011
Age : 40
Localisation : Pays de la Loire
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Demain, dès l'aube…
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.
Victor Hugo, Les Contemplations
Bacha Posh- Messages : 568
Date d'inscription : 21/06/2014
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
À une passante
La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d'une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet ;
Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son oeil, ciel livide où germe l'ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.
Un éclair… puis la nuit ! — Fugitive beauté
Dont le regard m'a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ?
Ailleurs, bien loin d'ici ! trop tard ! jamais peut-être !
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais !
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal
Bacha Posh- Messages : 568
Date d'inscription : 21/06/2014
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Charles Baudelaire
Les Fleurs du mal — Appendices
ÉBAUCHE D’UN ÉPILOGUE POUR LA 2e ÉDITION
Tranquille comme un sage et doux comme un maudit,
…j’ai dit:
Je t’aime, ô ma très belle, ô ma charmante…
Que de fois…
Tes débauches sans soif et tes amours sans âme,
Ton goût de l’infini
Qui partout, dans le mal lui-même, se proclame,
Tes bombes, tes poignards, tes victoires, tes fêtes,
Tes faubourgs mélancoliques,
Tes hôtels garnis,
Tes jardins pleins de soupirs et d’intrigues,
Tes temples vomissant la prière en musique,
Tes désespoirs d’enfant, tes jeux de vieille folle,
Tes découragements;
Et tes jeux d’artifice, éruptions de joie,
Qui font rire le Ciel, muet et ténébreux.
Ton vice vénérable étalé dans la soie,
Et ta vertu risible, au regard malheureux,
Douce, s’extasiant au luxe qu’il déploie…
Tes principes sauvés et tes lois conspuées,
Tes monuments hautains où s’accrochent les brumes.
Tes dômes de métal qu’enflamme le soleil,
Tes reines de théâtre aux voix enchanteresses,
Tes tocsins, tes canons, orchestre assourdissant,
Tes magiques pavés dressés en forteresses,
Tes petits orateurs, aux enflures baroques,
Prêchant l’amour, et puis tes égouts pleins de sang,
S’engouffrant dans l’Enfer comme des Orénoques,
Tes anges, tes bouffons neufs aux vieilles défroques
Anges revêtus d’or, de pourpre et d’hyacinthe,
Ô vous, soyez témoins que j’ai fait mon devoir
Comme un parfait chimiste et comme une âme sainte.
Car j’ai de chaque chose extrait la quintessence,
Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or.
Les Fleurs du mal — Appendices
ÉBAUCHE D’UN ÉPILOGUE POUR LA 2e ÉDITION
Tranquille comme un sage et doux comme un maudit,
…j’ai dit:
Je t’aime, ô ma très belle, ô ma charmante…
Que de fois…
Tes débauches sans soif et tes amours sans âme,
Ton goût de l’infini
Qui partout, dans le mal lui-même, se proclame,
Tes bombes, tes poignards, tes victoires, tes fêtes,
Tes faubourgs mélancoliques,
Tes hôtels garnis,
Tes jardins pleins de soupirs et d’intrigues,
Tes temples vomissant la prière en musique,
Tes désespoirs d’enfant, tes jeux de vieille folle,
Tes découragements;
Et tes jeux d’artifice, éruptions de joie,
Qui font rire le Ciel, muet et ténébreux.
Ton vice vénérable étalé dans la soie,
Et ta vertu risible, au regard malheureux,
Douce, s’extasiant au luxe qu’il déploie…
Tes principes sauvés et tes lois conspuées,
Tes monuments hautains où s’accrochent les brumes.
Tes dômes de métal qu’enflamme le soleil,
Tes reines de théâtre aux voix enchanteresses,
Tes tocsins, tes canons, orchestre assourdissant,
Tes magiques pavés dressés en forteresses,
Tes petits orateurs, aux enflures baroques,
Prêchant l’amour, et puis tes égouts pleins de sang,
S’engouffrant dans l’Enfer comme des Orénoques,
Tes anges, tes bouffons neufs aux vieilles défroques
Anges revêtus d’or, de pourpre et d’hyacinthe,
Ô vous, soyez témoins que j’ai fait mon devoir
Comme un parfait chimiste et comme une âme sainte.
Car j’ai de chaque chose extrait la quintessence,
Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or.
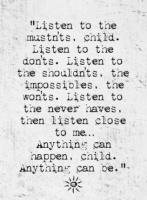
Princeton- Messages : 1367
Date d'inscription : 09/03/2014
Age : 35
Localisation : Paris
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Walt Whitman, Chanson des Joies. (trad : J. Darras)
- Spoiler:
- Car je veux écrire le plus jubilatoire des poèmes !
Un poème tout en musique - tout en virilité, tout en féminité, tout en puérilité !
Plénitude d'usages communs - foultitude d'arbres et de graines.
J'y veux la voix des animaux - la balance vivace des poissons !
Je veux qu'y tombent les gouttes de pluie musicalement !
Je veux qu'y brille le soleil que s'y meuve les vagues musicalement !
Sortie de ses cages la joie de mon esprit, filant comme une langue de foudre !
Posséder tel globe précis ou telle portion mesurée du temps ne me comblera pas,
Ce sont mille globes c'est l'ensemble complet du temps qu'il me faut !
J'envie la joie de l'ingénieur, je veux m'en aller sur la locomotive,
Entendre la compression de la vapeur, quel plaisir le hurlement de son sifflet, une locomotive qui rit !
Irrésistible la pression de la vitesse qui nous emporte à l'horizon.
Ce délice aussi de flâner par les collines et les prairies !
Feuilles et fleurs des humbles herbes communes, fraîcheur d'humidité des sous-bois,
Enivrant parfum de terre dans la prime aube, aux jeunes heures de l'après-midi.
Joie enviable de la cavalière, du cavalier en selle,
Petite pression avec les jambes pour le galop, et le coulis d'air murmurant aux oreilles, dans les cheveux.
J'envie la joie de l'homme du feu (fireman),
Dans le silence de la nuit l'alarme qui hurle,
Les cloches, les cris, vite je dépasse la foule, je cours !
Qui est fou de joie au spectacle des flammes qui brûlent ? c'est moi !
La joie du boxeur aux muscles saillants condition physique impeccable qui surplombe l'arène dans la certitude de sa puissance et le désir irrépressible d'affronter son adversaire, ah ! comme je l'envie !
Ah ! comme j'envie la sympathie élémentaire qu'émet à flots généreux et continus l'âme humaine et elle seule, vraiment oui comme je l'envie !
Et les joies de l'enfantement maternel !
La veille, la longue endurance, l'amour précieux, l'anxiété, le travail donneur de vie.
La croissance, l'accroissement, la compensation,
L'adoucissement, la pacification, la concorde, l'harmonie, non mais quelle joie !
Je voudrais tellement revenir au lieu de ma naissance
Tellement entendre chanter les petits oiseaux à nouveau
Tellement errer flâner dans la grange la maison à travers les champs à nouveau,
Tellement à travers le verger tellement sur les vieux chemins encore une fois.
Quel plaisir d'avoir grandi dans les baies, au bord des lagunes, des ruisseaux, des rivages,
Je voudrais continuer d'être employé là-bas toute ma vie
Ah ! cette odeur de sel et d'iode des molières, les algues parfumées à marée basse,
Le métier de la pêche, le travail du pêcheur d'anguilles, du pêcheur de palourdes,
Je suis venu avec mon râteau et ma bêche, suis venu avec mon trident à anguilles,
La mer a reflué au large ? Dans ce cas je m'agrège au groupe de palourdiers sur l'estran,
Plaisante, m'active avec eux, ironise sur mon efficacité avec la vitalité du jeune homme,
Prends mon panier à anguilles mon trident avec moi, quand c'est l'hiver, pour m'aventurer sur la glace - d'une hachette découpant des trous à la surface,
Regardez comme je suis chaudement vêtu, aller retour en une après-midi, regardez comme je suis joyeux, et cette ribambelle de jeunes costauds qui m'accompagne,
Adultes ou encore adolescents, aucun ne donnerait sa place pour rien au monde,
Ça leur plaît tellement d'être avec moi jour et nuit, au travail sur la plage, au sommeil dans ma chambre.
D'autres fois calme plat, on sort en canot pour aller relever les casiers à homards lestés de leurs lourdes pierres, je connais les repères,
Les balises, je rame dans leur direction, le soleil n'est pas encore levé mais ah ! cette douceur matinale de la lumière du cinquième Mois à la surface de l'eau autour de nous,
Je remonte obliquement les cages d'osier, carapaces vert sombre les bêtes traquées font assaut de toutes leurs pinces, j'insère une cheville en bois à l'articulation,
L'un après l'autre j'inspecte tous les casiers, puis à la rame retour au rivage,
Là où, dans une énorme marmite d'eau bouillante, seront jetés les homards jusqu'à ce que rougeur d'ensuive.
Un autre jour, pêche au maquereau,
Vorace lui, goulu du hameçon, nageant quasiment à la surface, on croirait voir l'eau couverte sur des milles;
Un autre jour encore, pêche à l'aiglefin dans la baie de Chesapeake, je fais partie de l'équipe, peau brune de lumière.
Une autre fois pêche au poisson bleu au large de Paumanok on laisse traîner une ligne derrière le bateau, c'est moi muscles en alertes,
Pied gauche calé sur le plat-bord, bras droit lançant très loin devant moi le serpentin de la fine corde,
À portée d'yeux d'une armada de cinquante esquifs, mes amis, qui filent et manœuvrent dans le vent.
Canoter sur les rivières, j'en rêve !
Descendre le Saint-Laurent, panorama grandiose, les vapeurs,
Les voiliers voiles claquantes, les Mille Îles, les trains de bois flottant qu'on rencontre avec leurs conducteurs aux longues perches-godilles recourbées,
Petit abri en bois, panache de fumée montant du feu où cuit le dîner.
(Et puis je veux du pernicieux, de l'horrible !
Je ne veux surtout pas d'une vie pieuse ni mesquine !
Je veux de l'inéprouvé, je veux de la transe !
Je veux échapper aux ancres, dériver en toute liberté !)
Je me vois mineur, forgeron,
Fondeur de fonte, fonderie même pas hautes toiture en tôle rugueuse, ampleur d'espace dans la pénombre,
Fourneau, versement du liquide en fusion.
Retrouver les joies du soldat, mais oui !
Sentir la présence à ses côtés d'un homme courageux, en sympathie avec soi, d'un commandant !
Quel admirable calme - se réchauffer au soleil de son sourire !
Monter au front - entendre le roulement de tambour, le clairon.
Les rafales de l'artillerie, voir l'étincellement des baïonnettes, des barillets dans la lumière jouant aux mousquets,
Voir tomber, mourir sans un cri des hommes !
Goûter au goût sauvage du sang - diaboliquement le désirer !
Plaisir gourmand de compter les plaies, les pertes infligées à l'ennemi.
Maintenant le baleinier, sa joie ! Me voici repartir de nouveau en expédition !
N'est-ce pas le mouvement du bateau sous mes pieds, n'est-ce pas la caresse des souffles atlantiques sur mon visage,
Dans mes oreilles n'est-ce pas soudain le cri de la vigie : There she blows !
Baleine à bâbord !
J'ai bondi dans le gréement, épiant avec les autres, nous voici fous d'excitation maintenant descendus de notre guet,
Je saute dans la baleinière, nous ramons vers notre proie,
Approche silencieuse, discrète, de la montagne massive, paresseusement léthargique,
Le harponneur s'est dressé, la flèche fuse à l'extrémité du bras puissant,
Rapide fuite au large de l'animal meurtri qui entraîne notre canot dans le vent, nous suivons la corde,
Et puis je le vois reprendre surface pour respirer, nous nous approchons,
Une lance va se ficher dans son flanc, de toute la force de la propulsion, qui sera tordue ensuite dans la plaie,
Nouveau recul, la bête repart, perdant son sang en abondance,
Jaillissement rouge comme elle reparaît, décrit des cercles de plus en plus courts, sillage hâtif dans l'eau - puis meurt, j'assiste à la scène,
Ultime cabrement convulsif au centre du cercle avant de retomber gisant immobile sur le dos dans l'écume sanglante.
Mais la joie la plus pure c'est ma vieillesse masculine qui me la donne !
Mes enfants, mes petits-enfants, mes cheveux blancs, ma barbe blanche,
Mon imposante stature, ma calme majesté, à la fin de cette longue perspective droite de la vie.
Mais la joie la plus mûre est celle de la féminité, du bonheur enfin atteint !
J'ai dépassé quatre-vingts ans, je suis l'aïeule la plus vénérable,
Clarté parfaite dans mon esprit - tout le monde, voyez, m'entoure d'attentions !
Quel est le secret de cette séduction plus forte que mes précédents charmes, quelle beauté s'épanouit en moi de parfum plus sucré que dans la fleur de ma jeunesse ?
D'où émane, d'où procède cette mystérieuse grâce qui est la mienne ?
Éprouver les joies de l'orateur !
Cette profonde inspiration qui soulève les côtes et gonfle la poitrine pour conduire à la gorge le roulement de tonnerre de la voix,
Faire communier avec soi-même le peuple, larmes ou rage, haines ou désirs,
Entraîner l'Amérique par sa langue, apaiser l'Amérique par ses mots !
Et puis la joie de mon âme aussi en son égale tempérance, prenant identité de toutes les matières, les aimant toutes, observant et absorbant chacune en leurs particularités,
Cependant qu'elles me la retournent en écho, toute vibrante des actes de la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'entendement, de la consécution, de la comparaison, de la mémoire, et autres facultés,
Elle la vie profonde en moi de mes sens, qui transcende les sens comme mon corps incarné,
Mon moi au-delà de la matière, ma vue au-delà de mes yeux matériels,
La preuve indiscutable à la minute même, mais bien sûr ! que ce ne sont pas mes yeux matériels qui voient,
Ni non plus mon corps matériel, mais bien entendu ! qui aime, qui marche, qui rit, qui crie, qui embrasse, qui procrée.
Et le fermier, que de joies !
L'homme de l'Ohio, l'Illinoisien, le Wisconsinien, le Kanadien, l'Iowan, le Kansien, le Missourien, l'Orégonais,
Au petit jour ils sont déjà debout, actifs sans effort apparent,
Ce sont les labours d'automne pour les semailles d'hiver,
Ce sont les labours du printemps pour le maïs,
Ce sont les arbres du verger à greffer, la cueillette automnale des pommes.
Je veux me baigner dans une baignade, choisir un endroit idéal du rivage,
Et entrer dans un éclaboussement d'eau, ou bien tremper tout juste mes chevilles ou alors courir tout nu sur le sable.
Oh ! l'espace, saisir sa réalité !
Qu'elle n'a pas de frontières, l'universelle plénitude,
S'unir d'un jaillissement avec le ciel, le soleil, la lune, les nuages fuyants.
Joie de l'indépendance masculine !
N'être esclave de personne, comptable de personne, tyran connu ou tyran anonyme,
Marcher droit devant soi, port droit, foulée souple, élastique,
Regard calme ou coup d’œil de l'éclair, regarder,
S'exprimer d'une voix pleine et sonore, poitrine bien dégagée,
Faisant face en personne aux autres personnalités ici-bas.
La richesse des joies de l'adolescence, les connais-tu ?
Les compagnons chéris, les plaisanteries ensemble, le rire sur le visage ?
La journée illuminée d'une radieuse lumière, la joie des jeux de souffle ?
La joie de la musique, les lampes dans la salle de bal, les danseurs ?
Le dîner copieux, la succession des toasts verre en main ?
Mon âme, mon âme suprême, écoute !
Connais-tu les joies de la méditation ?
Connais-tu le coeur solitaire mais joyeusement libre, sa tendresse dans la nuit ?
Connais-tu le plaisir de suivre un route orgueilleusement seul, même lorsque pèsent à l'esprit souffrances et déchirements ?
Connais-tu le plaisir angoissant des débats intimes, les rêveries grandioses fertiles en extases ?
La pensée de la Mort, des sphères du Temps et de l'Espace ?
Les prophéties d'amours idéales, d'essence plus pure, l'épouse divine, la douceur du camarade à l'inaltérable perfection ?
À toi toutes ces joies mon immortelle, on âme ! leur récompense te revient.
Aussi longtemps que je vivrai en maître de ma vie, non son esclave,
Aussi longtemps que j'affronterai la vie dans un esprit vainqueur,
Jamais de mauvaises brumes, jamais l'ennui, jamais les plaintes ni les critiques excoriantes,
Mais aux rudes lois de l'air, de l'eau, du sol cherchant critère incorruptible pour mon âme profonde
Je ne laisserai aucun gouvernement étranger me soumettre à son joug.
Je ne chante pas, je ne scande pas seulement la joie du Vivre - je chante la Mort, la joie de la Mort !
La caresse merveilleuse de la Mort, son apaisant engourdissement, sa brève persuasion,
Me voici déchargé de mon corps excrémentiel, qu'on le brûle, qu'on le rende à la poussière, qu'on l'enterre,
Reste mon corps réel pour mon usage sans doute dans d'autres sphères,
À quoi sert désormais mon enveloppe vide sinon à être purifiée pour des tâches futures, à être réemployée dans les usages éternels de la terre.
Je veux attirer par d'autres lois que l'attraction !
Comment m'y prendre, je ne sais pas, pourtant voyez cette obéissance qui n'obéit à rien,
Ce pouvoir magnétique, ah ! vraiment quelle force - toujours offensive, jamais défensive.
Oui, me battre contre des obstacles insurmontables, affronter des ennemis intraitables,
Seul à seul avec eux, pour mieux connaître mes limites d'endurance !
Face à face avec le combat, avec la torture, la prison, la haine générale !
Je monte à l'échafaud, j'avance sous la gueule des fusils, l'allure dégagée, totalement insouciante !
C'est cela, un dieu, je veux être un dieu !
M'embarquer à la mer !
Je veux tellement quitter ce sol insupportable,
Tellement quitter l'usante monotonie des rues, des maisons, des trottoirs,
Tellement te quitter terre compactement immuable, oui monter à bord d'un vaisseau,
Lever l'ancre, mettre à la voile, à la voile !
Je veux que désormais la vie soit un grand chant de joies !
Je veux danser, battre des mains, exulter et crier, sauter, bondir en l'air, me rouler par terre, surtout flotter, flotter !
Car je serai marin du monde partant pour tous les ports
Car je serai bateau (avez-vous vu mes voiles, déployées au soleil et à l'air ?),
Navire vif cales gonflées d'une précieuse cargaison de paroles et de joies.
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Un sonnet de Charles Cros, s'il vous plaît :
Moi, je vis la vie à côté,
Pleurant alors que c'est la fête.
Les gens disent : "Comme il est bête !"
En somme, je suis mal coté.
J'allume du feu dans l'été,
Dans l'usine je suis poète ;
Pour les pitres je fais la quête,
Qu'importe ! J'aime la beauté.
Beauté des pays et des femmes,
Beauté des vers, beauté des flammes,
Beauté du bien, beauté du mal.
J'ai trop étudié les choses ;
Le temps marche d'un pas normal :
Des roses, des roses, des roses !
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Keuwa ?! J'ai jamais mis Les Amis inconnus ici ? Ou alors j'ai foiré mon mirifique index... ?
Bon, dans le doute :
Bon, dans le doute :
Il vous naît un poisson qui se met à tourner
Tout de suite au plus noir d'une lame profonde,
Il vous naît une étoile au-dessus de la tête,
Elle voudrait chanter mais ne peut faire mieux
Que ses sœurs de la nuit les étoiles muettes.
Il vous naît un oiseau dans la force de l'âge,
En plein vol, et cachant votre histoire en son cœur
Puisqu'il n'a que son cri d'oiseau pour la montrer.
Il vole sur les bois, se choisit une branche
Et s'y pose, on dirait qu'elle est comme les autres.
Où courent-ils ainsi ces lièvres, ces belettes,
Il n'est pas de chasseur encor dans la contrée,
Et quelle peur les hante et les fait se hâter,
L'écureuil qui devient feuille et bois dans sa fuite,
La biche et le chevreuil soudain déconcertés ?
Il vous naît un ami, et voilà qu'il vous cherche
Il ne connaîtra pas votre nom ni vos yeux
Mais il faudra qu'il soit touché comme les autres
Et loge dans son cœur d'étranges battements
Qui lui viennent de jours qu'il n'aura pas vécus.
Et vous, que faites-vous, ô visage troublé,
Par ces brusques passants, ces bêtes, ces oiseaux,
Vous qui vous demandez, vous, toujours sans nouvelles
"Si je croise jamais un des amis lointains
Au mal que je lui fis vais-je le reconnaître ?"
Pardon pour vous, pardon pour eux, pour le silence
Et les mots inconsidérés,
Pour les phrases venant de lèvres inconnues
Qui vous touchent de loin comme balles perdues,
Et pardon pour les fronts qui semblent oublieux.
Dernière édition par Alphonsine le Mer 1 Oct 2014 - 14:54, édité 1 fois (Raison : Sans les fautes, c'est mieux.)
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
A ceux qui sont petits
Est-ce ma faute à moi si vous n'êtes pas grands ?
Vous aimez les hiboux, les fouines, les tyrans,
Le mistral, le simoun, l'écueil, la lune rousse ;
Vous êtes Myrmidon que son néant courrouce ;
Hélas ! l'envie en vous creuse son puits sans fond,
Et je vous plains. Le plomb de votre style fond
Et coule sur les noms que dore un peu de gloire,
Et, tout en répandant sa triste lave noire,
Tâche d'être cuisant et ne peut qu'être lourd.
Tortueux, vous rampez après tout ce qui court ;
Votre oeil furieux suit les grands aigles véloces.
Vous reprochez leur taille et leur ombre aux colosses ;
On dit de vous : - Pygmée essaya, mais ne put.-
Qui haïra Chéops si ce n'est Lilliput ?
Le Parthénon vous blesse avec ses fiers pilastres ;
Vous êtes malheureux de la beauté des astres ;
Vous trouvez l'océan trop clair, trop noir, trop bleu ;
Vous détestez le ciel parce qu'il montre Dieu ;
Vous êtes mécontents que tout soit quelque chose ;
Hélas, vous n'êtes rien. Vous souffrez de la rose,
Du cygne, du printemps pas assez pluvieux.
Et ce qui rit vous mord. Vous êtes envieux
De voir voler la mouche et de voir le ver luire.
Dans votre jalousie acharnée à détruire
Vous comprenez quiconque aime, quiconque a foi,
Et même vous avez de la place pour moi !
Un brin d'herbe vous fait grincer s'il vous dépasse ;
Vous avez pour le monde auguste, pour l'espace,
Pour tout ce qu'on voit croître, éclairer, réchauffer,
L'infâme embrassement qui voudrait étouffer.
Vous avez juste autant de pitié que le glaive.
En regardant un champ vous maudissez la sève ;
L'arbre vous plaît à l'heure où la hache le fend ;
Vous avez quelque chose en vous qui vous défend
D'être bons, et la rage est votre rêverie.
Votre âme a froid par où la nôtre est attendrie ;
Vous avez la nausée où nous sentons l'aimant ;
Vous êtes monstrueux tout naturellement.
Vous grondez quand l'oiseau chante sous les grands ormes.
Quand la fleur, près de vous qui vous sentez difformes,
Est belle, vous croyez qu'elle le fait exprès.
Quel souffle vous auriez si l'étoile était près !
Vous croyez qu'en brillant la lumière vous blâme ;
Vous vous imaginez, en voyant une femme,
Que c'est pour vous narguer qu'elle prend un amant,
Et que le mois de mai vous verse méchamment
Son urne de rayons et d'encens sur la tête ;
Il vous semble qu'alors que les bois sont en fête,
Que l'herbe est embaumée et que les prés sont doux,
Heureux, frais, parfumés, charmants, c'est contre vous.
Vous criez : au secours ! quand le soleil se lève.
Vous exécrez sans but, sans choix, sans fin, sans trêve,
Sans effort, par instinct, pour mentir, pour trahir ;
Ce n'est pas un travail pour vous de tout haïr,
Fourmis, vous abhorrez l'immensité sans peine.
C'est votre joie impie, âcre, cynique, obscène.
Et vous souffrez. Car rien, hélas, n'est châtié
Autant que l'avorton, géant d'inimitié !
Si l'oeil pouvait plonger sous la voûte chétive
De votre crâne étroit qu'un instinct vil captive,
On y verrait l'énorme horizon de la nuit ;
Vous êtes ce qui bave, ignore, insulte et nuit ;
La montagne du mal est dans votre âme naine.
Plus le coeur est petit, plus il y tient de haine.
~ Victor Hugo
Est-ce ma faute à moi si vous n'êtes pas grands ?
Vous aimez les hiboux, les fouines, les tyrans,
Le mistral, le simoun, l'écueil, la lune rousse ;
Vous êtes Myrmidon que son néant courrouce ;
Hélas ! l'envie en vous creuse son puits sans fond,
Et je vous plains. Le plomb de votre style fond
Et coule sur les noms que dore un peu de gloire,
Et, tout en répandant sa triste lave noire,
Tâche d'être cuisant et ne peut qu'être lourd.
Tortueux, vous rampez après tout ce qui court ;
Votre oeil furieux suit les grands aigles véloces.
Vous reprochez leur taille et leur ombre aux colosses ;
On dit de vous : - Pygmée essaya, mais ne put.-
Qui haïra Chéops si ce n'est Lilliput ?
Le Parthénon vous blesse avec ses fiers pilastres ;
Vous êtes malheureux de la beauté des astres ;
Vous trouvez l'océan trop clair, trop noir, trop bleu ;
Vous détestez le ciel parce qu'il montre Dieu ;
Vous êtes mécontents que tout soit quelque chose ;
Hélas, vous n'êtes rien. Vous souffrez de la rose,
Du cygne, du printemps pas assez pluvieux.
Et ce qui rit vous mord. Vous êtes envieux
De voir voler la mouche et de voir le ver luire.
Dans votre jalousie acharnée à détruire
Vous comprenez quiconque aime, quiconque a foi,
Et même vous avez de la place pour moi !
Un brin d'herbe vous fait grincer s'il vous dépasse ;
Vous avez pour le monde auguste, pour l'espace,
Pour tout ce qu'on voit croître, éclairer, réchauffer,
L'infâme embrassement qui voudrait étouffer.
Vous avez juste autant de pitié que le glaive.
En regardant un champ vous maudissez la sève ;
L'arbre vous plaît à l'heure où la hache le fend ;
Vous avez quelque chose en vous qui vous défend
D'être bons, et la rage est votre rêverie.
Votre âme a froid par où la nôtre est attendrie ;
Vous avez la nausée où nous sentons l'aimant ;
Vous êtes monstrueux tout naturellement.
Vous grondez quand l'oiseau chante sous les grands ormes.
Quand la fleur, près de vous qui vous sentez difformes,
Est belle, vous croyez qu'elle le fait exprès.
Quel souffle vous auriez si l'étoile était près !
Vous croyez qu'en brillant la lumière vous blâme ;
Vous vous imaginez, en voyant une femme,
Que c'est pour vous narguer qu'elle prend un amant,
Et que le mois de mai vous verse méchamment
Son urne de rayons et d'encens sur la tête ;
Il vous semble qu'alors que les bois sont en fête,
Que l'herbe est embaumée et que les prés sont doux,
Heureux, frais, parfumés, charmants, c'est contre vous.
Vous criez : au secours ! quand le soleil se lève.
Vous exécrez sans but, sans choix, sans fin, sans trêve,
Sans effort, par instinct, pour mentir, pour trahir ;
Ce n'est pas un travail pour vous de tout haïr,
Fourmis, vous abhorrez l'immensité sans peine.
C'est votre joie impie, âcre, cynique, obscène.
Et vous souffrez. Car rien, hélas, n'est châtié
Autant que l'avorton, géant d'inimitié !
Si l'oeil pouvait plonger sous la voûte chétive
De votre crâne étroit qu'un instinct vil captive,
On y verrait l'énorme horizon de la nuit ;
Vous êtes ce qui bave, ignore, insulte et nuit ;
La montagne du mal est dans votre âme naine.
Plus le coeur est petit, plus il y tient de haine.
~ Victor Hugo
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Lyhan a écrit:Plus le coeur est petit, plus il y tient de haine.
Plus le coeur est petit, moins il peut contenir d'amour.
Bacha Posh- Messages : 568
Date d'inscription : 21/06/2014
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Le firmament est plein de la vaste clarté
Le firmament est plein de la vaste clarté ;
Tout est joie, innocence, espoir, bonheur, bonté.
Le beau lac brille au fond du vallon qui le mure ;
Le champ sera fécond, la vigne sera mûre ;
Tout regorge de sève et de vie et de bruit,
De rameaux verts, d'azur frissonnant, d'eau qui luit,
Et de petits oiseaux qui se cherchent querelle.
Qu'a donc le papillon ? qu'a donc la sauterelle ?
La sauterelle à l'herbe, et le papillon l'air ;
Et tous deux ont avril, qui rit dans le ciel clair.
Un refrain joyeux sort de la nature entière ;
Chanson qui doucement monte et devient prière.
Le poussin court, l'enfant joue et danse, l'agneau
Saute, et, laissant tomber goutte à goutte son eau,
Le vieux antre, attendri, pleure comme un visage ;
Le vent lit à quelqu'un d'invisible un passage
Du poème inouï de la création ;
L'oiseau parle au parfum; la fleur parle au rayon ;
Les pins sur les étangs dressent leur verte ombelle ;
Les nids ont chaud ; l'azur trouve la terre belle,
Onde et sphère, à la fois tous les climats flottants ;
Ici l'automne, ici l'été ; là le printemps.
Ô coteaux ! ô sillons ! souffles, soupirs, haleines !
L'hosanna des forêts, des fleuves et des plaines,
S'élève gravement vers Dieu, père du jour ;
Et toutes les blancheurs sont des strophes d'amour ;
Le cygne dit : Lumière ! et le lys dit : Clémence
Le ciel s'ouvre à ce chant comme une oreille immense.
Le soir vient ; et le globe à son tour s'éblouit,
Devient un œil énorme et regarde la nuit ;
Il savoure, éperdu, l'immensité sacrée,
La contemplation du splendide empyrée,
Les nuages de crêpe et d'argent, le zénith,
Qui, formidable, brille et flamboie et bénit,
Les constellations, ces hydres étoilées,
Les effluves du sombre et du profond, mêlées
À vos effusions, astres de diamant,
Et toute l'ombre avec tout le rayonnement !
L'infini tout entier d'extase se soulève.
Et, pendant ce temps-là, Satan, l'envieux, rêve.
Victor Hugo, Les Contemplations
Le firmament est plein de la vaste clarté ;
Tout est joie, innocence, espoir, bonheur, bonté.
Le beau lac brille au fond du vallon qui le mure ;
Le champ sera fécond, la vigne sera mûre ;
Tout regorge de sève et de vie et de bruit,
De rameaux verts, d'azur frissonnant, d'eau qui luit,
Et de petits oiseaux qui se cherchent querelle.
Qu'a donc le papillon ? qu'a donc la sauterelle ?
La sauterelle à l'herbe, et le papillon l'air ;
Et tous deux ont avril, qui rit dans le ciel clair.
Un refrain joyeux sort de la nature entière ;
Chanson qui doucement monte et devient prière.
Le poussin court, l'enfant joue et danse, l'agneau
Saute, et, laissant tomber goutte à goutte son eau,
Le vieux antre, attendri, pleure comme un visage ;
Le vent lit à quelqu'un d'invisible un passage
Du poème inouï de la création ;
L'oiseau parle au parfum; la fleur parle au rayon ;
Les pins sur les étangs dressent leur verte ombelle ;
Les nids ont chaud ; l'azur trouve la terre belle,
Onde et sphère, à la fois tous les climats flottants ;
Ici l'automne, ici l'été ; là le printemps.
Ô coteaux ! ô sillons ! souffles, soupirs, haleines !
L'hosanna des forêts, des fleuves et des plaines,
S'élève gravement vers Dieu, père du jour ;
Et toutes les blancheurs sont des strophes d'amour ;
Le cygne dit : Lumière ! et le lys dit : Clémence
Le ciel s'ouvre à ce chant comme une oreille immense.
Le soir vient ; et le globe à son tour s'éblouit,
Devient un œil énorme et regarde la nuit ;
Il savoure, éperdu, l'immensité sacrée,
La contemplation du splendide empyrée,
Les nuages de crêpe et d'argent, le zénith,
Qui, formidable, brille et flamboie et bénit,
Les constellations, ces hydres étoilées,
Les effluves du sombre et du profond, mêlées
À vos effusions, astres de diamant,
Et toute l'ombre avec tout le rayonnement !
L'infini tout entier d'extase se soulève.
Et, pendant ce temps-là, Satan, l'envieux, rêve.
Victor Hugo, Les Contemplations
Bacha Posh- Messages : 568
Date d'inscription : 21/06/2014
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Index mis à jour ! Et merci à Sarty pour l'entrée de Walt Whitman dans cette anthologie personnalisée et à Princeton pour cette ébauche méconnue ! *fait des découvertes*
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
.
Dernière édition par Subrisio Saltat. le Dim 15 Nov 2015 - 17:42, édité 1 fois

Subrisio Saltat.- Messages : 174
Date d'inscription : 25/08/2014
Age : 37
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Louis Aragon - Il n’y a pas d’amour heureux
Rien n’est jamais acquis à l’homme Ni sa force
Ni sa faiblesse ni son coeur Et quand il croit
Ouvrir ses bras son ombre est celle d’une croix
Et quand il croit serrer son bonheur il le broie
Sa vie est un étrange et douloureux divorce
Il n’y a pas d’amour heureux
Sa vie Elle ressemble à ces soldats sans armes
Qu’on avait habillés pour un autre destin
A quoi peut leur servir de se lever matin
Eux qu’on retrouve au soir désoeuvrés incertains
Dites ces mots Ma vie Et retenez vos larmes
Il n’y a pas d’amour heureux
Mon bel amour mon cher amour ma déchirure
Je te porte dans moi comme un oiseau blessé
Et ceux-là sans savoir nous regardent passer
Répétant après moi les mots que j’ai tressés
Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent
Il n’y a pas d’amour heureux
Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard
Que pleurent dans la nuit nos coeurs à l’unisson
Ce qu’il faut de malheur pour la moindre chanson
Ce qu’il faut de regrets pour payer un frisson
Ce qu’il faut de sanglots pour un air de guitare
Il n’y a pas d’amour heureux
Il n’y a pas d’amour qui ne soit à douleur
Il n’y a pas d’amour dont on ne soit meurtri
Il n’y a pas d’amour dont on ne soit flétri
Et pas plus que de toi l’amour de la patrie
Il n’y a pas d’amour qui ne vive de pleurs
Il n’y a pas d’amour heureux
Mais c’est notre amour à tous les deux
Et la poignante mise en musique par Georges Brassens :
Rien n’est jamais acquis à l’homme Ni sa force
Ni sa faiblesse ni son coeur Et quand il croit
Ouvrir ses bras son ombre est celle d’une croix
Et quand il croit serrer son bonheur il le broie
Sa vie est un étrange et douloureux divorce
Il n’y a pas d’amour heureux
Sa vie Elle ressemble à ces soldats sans armes
Qu’on avait habillés pour un autre destin
A quoi peut leur servir de se lever matin
Eux qu’on retrouve au soir désoeuvrés incertains
Dites ces mots Ma vie Et retenez vos larmes
Il n’y a pas d’amour heureux
Mon bel amour mon cher amour ma déchirure
Je te porte dans moi comme un oiseau blessé
Et ceux-là sans savoir nous regardent passer
Répétant après moi les mots que j’ai tressés
Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent
Il n’y a pas d’amour heureux
Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard
Que pleurent dans la nuit nos coeurs à l’unisson
Ce qu’il faut de malheur pour la moindre chanson
Ce qu’il faut de regrets pour payer un frisson
Ce qu’il faut de sanglots pour un air de guitare
Il n’y a pas d’amour heureux
Il n’y a pas d’amour qui ne soit à douleur
Il n’y a pas d’amour dont on ne soit meurtri
Il n’y a pas d’amour dont on ne soit flétri
Et pas plus que de toi l’amour de la patrie
Il n’y a pas d’amour qui ne vive de pleurs
Il n’y a pas d’amour heureux
Mais c’est notre amour à tous les deux
Et la poignante mise en musique par Georges Brassens :

Kodiak- Messages : 1904
Date d'inscription : 05/11/2013
Age : 61
Localisation : Nice
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Pour diversifier un peu, moi je donne dans la poésie anglophone  (parce que bon, Baudelaire, j'aime beaucoup, mais...)
(parce que bon, Baudelaire, j'aime beaucoup, mais...)
The Sick Rose - William Blake
O Rose thou art sick.
The invisible worm,
That flies in the night
In the howling storm:
Has found out thy bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy.
 (parce que bon, Baudelaire, j'aime beaucoup, mais...)
(parce que bon, Baudelaire, j'aime beaucoup, mais...)The Sick Rose - William Blake
O Rose thou art sick.
The invisible worm,
That flies in the night
In the howling storm:
Has found out thy bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy.
- celui-là est un peu long, je le mets donc sous spoiler. mais c'est pas parce que je l'aime moins:
Goblin Market - Christina Rossetti
Morning and evening
Maids heard the goblins cry:
“Come buy our orchard fruits,
Come buy, come buy:
Apples and quinces,
Lemons and oranges,
Plump unpeck’d cherries,
Melons and raspberries,
Bloom-down-cheek’d peaches,
Swart-headed mulberries,
Wild free-born cranberries,
Crab-apples, dewberries,
Pine-apples, blackberries,
Apricots, strawberries;—
All ripe together
In summer weather,—
Morns that pass by,
Fair eves that fly;
Come buy, come buy:
Our grapes fresh from the vine,
Pomegranates full and fine,
Dates and sharp bullaces,
Rare pears and greengages,
Damsons and bilberries,
Taste them and try:
Currants and gooseberries,
Bright-fire-like barberries,
Figs to fill your mouth,
Citrons from the South,
Sweet to tongue and sound to eye;
Come buy, come buy.”
Evening by evening
Among the brookside rushes,
Laura bow’d her head to hear,
Lizzie veil’d her blushes:
Crouching close together
In the cooling weather,
With clasping arms and cautioning lips,
With tingling cheeks and finger tips.
“Lie close,” Laura said,
Pricking up her golden head:
“We must not look at goblin men,
We must not buy their fruits:
Who knows upon what soil they fed
Their hungry thirsty roots?”
“Come buy,” call the goblins
Hobbling down the glen.
“Oh,” cried Lizzie, “Laura, Laura,
You should not peep at goblin men.”
Lizzie cover’d up her eyes,
Cover’d close lest they should look;
Laura rear’d her glossy head,
And whisper’d like the restless brook:
“Look, Lizzie, look, Lizzie,
Down the glen tramp little men.
One hauls a basket,
One bears a plate,
One lugs a golden dish
Of many pounds weight.
How fair the vine must grow
Whose grapes are so luscious;
How warm the wind must blow
Through those fruit bushes.”
“No,” said Lizzie, “No, no, no;
Their offers should not charm us,
Their evil gifts would harm us.”
She thrust a dimpled finger
In each ear, shut eyes and ran:
Curious Laura chose to linger
Wondering at each merchant man.
One had a cat’s face,
One whisk’d a tail,
One tramp’d at a rat’s pace,
One crawl’d like a snail,
One like a wombat prowl’d obtuse and furry,
One like a ratel tumbled hurry skurry.
She heard a voice like voice of doves
Cooing all together:
They sounded kind and full of loves
In the pleasant weather.
Laura stretch’d her gleaming neck
Like a rush-imbedded swan,
Like a lily from the beck,
Like a moonlit poplar branch,
Like a vessel at the launch
When its last restraint is gone.
Backwards up the mossy glen
Turn’d and troop’d the goblin men,
With their shrill repeated cry,
“Come buy, come buy.”
When they reach’d where Laura was
They stood stock still upon the moss,
Leering at each other,
Brother with queer brother;
Signalling each other,
Brother with sly brother.
One set his basket down,
One rear’d his plate;
One began to weave a crown
Of tendrils, leaves, and rough nuts brown
(Men sell not such in any town);
One heav’d the golden weight
Of dish and fruit to offer her:
“Come buy, come buy,” was still their cry.
Laura stared but did not stir,
Long’d but had no money:
The whisk-tail’d merchant bade her taste
In tones as smooth as honey,
The cat-faced purr’d,
The rat-faced spoke a word
Of welcome, and the snail-paced even was heard;
One parrot-voiced and jolly
Cried “Pretty Goblin” still for “Pretty Polly;”—
One whistled like a bird.
But sweet-tooth Laura spoke in haste:
“Good folk, I have no coin;
To take were to purloin:
I have no copper in my purse,
I have no silver either,
And all my gold is on the furze
That shakes in windy weather
Above the rusty heather.”
“You have much gold upon your head,”
They answer’d all together:
“Buy from us with a golden curl.”
She clipp’d a precious golden lock,
She dropp’d a tear more rare than pearl,
Then suck’d their fruit globes fair or red:
Sweeter than honey from the rock,
Stronger than man-rejoicing wine,
Clearer than water flow’d that juice;
She never tasted such before,
How should it cloy with length of use?
She suck’d and suck’d and suck’d the more
Fruits which that unknown orchard bore;
She suck’d until her lips were sore;
Then flung the emptied rinds away
But gather’d up one kernel stone,
And knew not was it night or day
As she turn’d home alone.
Lizzie met her at the gate
Full of wise upbraidings:
“Dear, you should not stay so late,
Twilight is not good for maidens;
Should not loiter in the glen
In the haunts of goblin men.
Do you not remember Jeanie,
How she met them in the moonlight,
Took their gifts both choice and many,
Ate their fruits and wore their flowers
Pluck’d from bowers
Where summer ripens at all hours?
But ever in the noonlight
She pined and pined away;
Sought them by night and day,
Found them no more, but dwindled and grew grey;
Then fell with the first snow,
While to this day no grass will grow
Where she lies low:
I planted daisies there a year ago
That never blow.
You should not loiter so.”
“Nay, hush,” said Laura:
“Nay, hush, my sister:
I ate and ate my fill,
Yet my mouth waters still;
To-morrow night I will
Buy more;” and kiss’d her:
“Have done with sorrow;
I’ll bring you plums to-morrow
Fresh on their mother twigs,
Cherries worth getting;
You cannot think what figs
My teeth have met in,
What melons icy-cold
Piled on a dish of gold
Too huge for me to hold,
What peaches with a velvet nap,
Pellucid grapes without one seed:
Odorous indeed must be the mead
Whereon they grow, and pure the wave they drink
With lilies at the brink,
And sugar-sweet their sap.”
Golden head by golden head,
Like two pigeons in one nest
Folded in each other’s wings,
They lay down in their curtain’d bed:
Like two blossoms on one stem,
Like two flakes of new-fall’n snow,
Like two wands of ivory
Tipp’d with gold for awful kings.
Moon and stars gaz’d in at them,
Wind sang to them lullaby,
Lumbering owls forbore to fly,
Not a bat flapp’d to and fro
Round their rest:
Cheek to cheek and breast to breast
Lock’d together in one nest.
Early in the morning
When the first cock crow’d his warning,
Neat like bees, as sweet and busy,
Laura rose with Lizzie:
Fetch’d in honey, milk’d the cows,
Air’d and set to rights the house,
Kneaded cakes of whitest wheat,
Cakes for dainty mouths to eat,
Next churn’d butter, whipp’d up cream,
Fed their poultry, sat and sew’d;
Talk’d as modest maidens should:
Lizzie with an open heart,
Laura in an absent dream,
One content, one sick in part;
One warbling for the mere bright day’s delight,
One longing for the night.
At length slow evening came:
They went with pitchers to the reedy brook;
Lizzie most placid in her look,
Laura most like a leaping flame.
They drew the gurgling water from its deep;
Lizzie pluck’d purple and rich golden flags,
Then turning homeward said: “The sunset flushes
Those furthest loftiest crags;
Come, Laura, not another maiden lags.
No wilful squirrel wags,
The beasts and birds are fast asleep.”
But Laura loiter’d still among the rushes
And said the bank was steep.
And said the hour was early still
The dew not fall’n, the wind not chill;
Listening ever, but not catching
The customary cry,
“Come buy, come buy,”
With its iterated jingle
Of sugar-baited words:
Not for all her watching
Once discerning even one goblin
Racing, whisking, tumbling, hobbling;
Let alone the herds
That used to tramp along the glen,
In groups or single,
Of brisk fruit-merchant men.
Till Lizzie urged, “O Laura, come;
I hear the fruit-call but I dare not look:
You should not loiter longer at this brook:
Come with me home.
The stars rise, the moon bends her arc,
Each glowworm winks her spark,
Let us get home before the night grows dark:
For clouds may gather
Though this is summer weather,
Put out the lights and drench us through;
Then if we lost our way what should we do?”
Laura turn’d cold as stone
To find her sister heard that cry alone,
That goblin cry,
“Come buy our fruits, come buy.”
Must she then buy no more such dainty fruit?
Must she no more such succous pasture find,
Gone deaf and blind?
Her tree of life droop’d from the root:
She said not one word in her heart’s sore ache;
But peering thro’ the dimness, nought discerning,
Trudg’d home, her pitcher dripping all the way;
So crept to bed, and lay
Silent till Lizzie slept;
Then sat up in a passionate yearning,
And gnash’d her teeth for baulk’d desire, and wept
As if her heart would break.
Day after day, night after night,
Laura kept watch in vain
In sullen silence of exceeding pain.
She never caught again the goblin cry:
“Come buy, come buy;”—
She never spied the goblin men
Hawking their fruits along the glen:
But when the noon wax’d bright
Her hair grew thin and grey;
She dwindled, as the fair full moon doth turn
To swift decay and burn
Her fire away.
One day remembering her kernel-stone
She set it by a wall that faced the south;
Dew’d it with tears, hoped for a root,
Watch’d for a waxing shoot,
But there came none;
It never saw the sun,
It never felt the trickling moisture run:
While with sunk eyes and faded mouth
She dream’d of melons, as a traveller sees
False waves in desert drouth
With shade of leaf-crown’d trees,
And burns the thirstier in the sandful breeze.
She no more swept the house,
Tended the fowls or cows,
Fetch’d honey, kneaded cakes of wheat,
Brought water from the brook:
But sat down listless in the chimney-nook
And would not eat.
Tender Lizzie could not bear
To watch her sister’s cankerous care
Yet not to share.
She night and morning
Caught the goblins’ cry:
“Come buy our orchard fruits,
Come buy, come buy;”—
Beside the brook, along the glen,
She heard the tramp of goblin men,
The yoke and stir
Poor Laura could not hear;
Long’d to buy fruit to comfort her,
But fear’d to pay too dear.
She thought of Jeanie in her grave,
Who should have been a bride;
But who for joys brides hope to have
Fell sick and died
In her gay prime,
In earliest winter time
With the first glazing rime,
With the first snow-fall of crisp winter time.
Till Laura dwindling
Seem’d knocking at Death’s door:
Then Lizzie weigh’d no more
Better and worse;
But put a silver penny in her purse,
Kiss’d Laura, cross’d the heath with clumps of furze
At twilight, halted by the brook:
And for the first time in her life
Began to listen and look.
Laugh’d every goblin
When they spied her peeping:
Came towards her hobbling,
Flying, running, leaping,
Puffing and blowing,
Chuckling, clapping, crowing,
Clucking and gobbling,
Mopping and mowing,
Full of airs and graces,
Pulling wry faces,
Demure grimaces,
Cat-like and rat-like,
Ratel- and wombat-like,
Snail-paced in a hurry,
Parrot-voiced and whistler,
Helter skelter, hurry skurry,
Chattering like magpies,
Fluttering like pigeons,
Gliding like fishes,—
Hugg’d her and kiss’d her:
Squeez’d and caress’d her:
Stretch’d up their dishes,
Panniers, and plates:
“Look at our apples
Russet and dun,
Bob at our cherries,
Bite at our peaches,
Citrons and dates,
Grapes for the asking,
Pears red with basking
Out in the sun,
Plums on their twigs;
Pluck them and suck them,
Pomegranates, figs.”—
“Good folk,” said Lizzie,
Mindful of Jeanie:
“Give me much and many: —
Held out her apron,
Toss’d them her penny.
“Nay, take a seat with us,
Honour and eat with us,”
They answer’d grinning:
“Our feast is but beginning.
Night yet is early,
Warm and dew-pearly,
Wakeful and starry:
Such fruits as these
No man can carry:
Half their bloom would fly,
Half their dew would dry,
Half their flavour would pass by.
Sit down and feast with us,
Be welcome guest with us,
Cheer you and rest with us.”—
“Thank you,” said Lizzie: “But one waits
At home alone for me:
So without further parleying,
If you will not sell me any
Of your fruits though much and many,
Give me back my silver penny
I toss’d you for a fee.”—
They began to scratch their pates,
No longer wagging, purring,
But visibly demurring,
Grunting and snarling.
One call’d her proud,
Cross-grain’d, uncivil;
Their tones wax’d loud,
Their looks were evil.
Lashing their tails
They trod and hustled her,
Elbow’d and jostled her,
Claw’d with their nails,
Barking, mewing, hissing, mocking,
Tore her gown and soil’d her stocking,
Twitch’d her hair out by the roots,
Stamp’d upon her tender feet,
Held her hands and squeez’d their fruits
Against her mouth to make her eat.
White and golden Lizzie stood,
Like a lily in a flood,—
Like a rock of blue-vein’d stone
Lash’d by tides obstreperously,—
Like a beacon left alone
In a hoary roaring sea,
Sending up a golden fire,—
Like a fruit-crown’d orange-tree
White with blossoms honey-sweet
Sore beset by wasp and bee,—
Like a royal virgin town
Topp’d with gilded dome and spire
Close beleaguer’d by a fleet
Mad to tug her standard down.
One may lead a horse to water,
Twenty cannot make him drink.
Though the goblins cuff’d and caught her,
Coax’d and fought her,
Bullied and besought her,
Scratch’d her, pinch’d her black as ink,
Kick’d and knock’d her,
Maul’d and mock’d her,
Lizzie utter’d not a word;
Would not open lip from lip
Lest they should cram a mouthful in:
But laugh’d in heart to feel the drip
Of juice that syrupp’d all her face,
And lodg’d in dimples of her chin,
And streak’d her neck which quaked like curd.
At last the evil people,
Worn out by her resistance,
Flung back her penny, kick’d their fruit
Along whichever road they took,
Not leaving root or stone or shoot;
Some writh’d into the ground,
Some div’d into the brook
With ring and ripple,
Some scudded on the gale without a sound,
Some vanish’d in the distance.
In a smart, ache, tingle,
Lizzie went her way;
Knew not was it night or day;
Sprang up the bank, tore thro’ the furze,
Threaded copse and dingle,
And heard her penny jingle
Bouncing in her purse,—
Its bounce was music to her ear.
She ran and ran
As if she fear’d some goblin man
Dogg’d her with gibe or curse
Or something worse:
But not one goblin scurried after,
Nor was she prick’d by fear;
The kind heart made her windy-paced
That urged her home quite out of breath with haste
And inward laughter.
She cried, “Laura,” up the garden,
“Did you miss me?
Come and kiss me.
Never mind my bruises,
Hug me, kiss me, suck my juices
Squeez’d from goblin fruits for you,
Goblin pulp and goblin dew.
Eat me, drink me, love me;
Laura, make much of me;
For your sake I have braved the glen
And had to do with goblin merchant men.”
Laura started from her chair,
Flung her arms up in the air,
Clutch’d her hair:
“Lizzie, Lizzie, have you tasted
For my sake the fruit forbidden?
Must your light like mine be hidden,
Your young life like mine be wasted,
Undone in mine undoing,
And ruin’d in my ruin,
Thirsty, canker’d, goblin-ridden?”—
She clung about her sister,
Kiss’d and kiss’d and kiss’d her:
Tears once again
Refresh’d her shrunken eyes,
Dropping like rain
After long sultry drouth;
Shaking with aguish fear, and pain,
She kiss’d and kiss’d her with a hungry mouth.
Her lips began to scorch,
That juice was wormwood to her tongue,
She loath’d the feast:
Writhing as one possess’d she leap’d and sung,
Rent all her robe, and wrung
Her hands in lamentable haste,
And beat her breast.
Her locks stream’d like the torch
Borne by a racer at full speed,
Or like the mane of horses in their flight,
Or like an eagle when she stems the light
Straight toward the sun,
Or like a caged thing freed,
Or like a flying flag when armies run.
Swift fire spread through her veins, knock’d at her heart,
Met the fire smouldering there
And overbore its lesser flame;
She gorged on bitterness without a name:
Ah! fool, to choose such part
Of soul-consuming care!
Sense fail’d in the mortal strife:
Like the watch-tower of a town
Which an earthquake shatters down,
Like a lightning-stricken mast,
Like a wind-uprooted tree
Spun about,
Like a foam-topp’d waterspout
Cast down headlong in the sea,
She fell at last;
Pleasure past and anguish past,
Is it death or is it life?
Life out of death.
That night long Lizzie watch’d by her,
Counted her pulse’s flagging stir,
Felt for her breath,
Held water to her lips, and cool’d her face
With tears and fanning leaves:
But when the first birds chirp’d about their eaves,
And early reapers plodded to the place
Of golden sheaves,
And dew-wet grass
Bow’d in the morning winds so brisk to pass,
And new buds with new day
Open’d of cup-like lilies on the stream,
Laura awoke as from a dream,
Laugh’d in the innocent old way,
Hugg’d Lizzie but not twice or thrice;
Her gleaming locks show’d not one thread of grey,
Her breath was sweet as May
And light danced in her eyes.
Days, weeks, months, years
Afterwards, when both were wives
With children of their own;
Their mother-hearts beset with fears,
Their lives bound up in tender lives;
Laura would call the little ones
And tell them of her early prime,
Those pleasant days long gone
Of not-returning time:
Would talk about the haunted glen,
The wicked, quaint fruit-merchant men,
Their fruits like honey to the throat
But poison in the blood;
(Men sell not such in any town):
Would tell them how her sister stood
In deadly peril to do her good,
And win the fiery antidote:
Then joining hands to little hands
Would bid them cling together,
“For there is no friend like a sister
In calm or stormy weather;
To cheer one on the tedious way,
To fetch one if one goes astray,
To lift one if one totters down,
To strengthen whilst one stands.”
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
- La lune s'attristait. Des séraphins en pleurs
Rêvant, l'archet aux doigts, dans le calme des fleurs
Vaporeuses, tiraient de mourantes violes
De blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles.
– C'était le jour béni de ton premier baiser.
Ma songerie, aimant à me martyriser,
S'enivrait savamment du parfum de tristesse
Que même sans regret et sans déboire laisse
La cueillaison d'un Rêve au cœur qui l'a cueilli.
J'errais donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli,
Quand, avec du soleil aux cheveux, dans la rue
Et dans le soir, tu m'es en riant apparue
Et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté
Qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant gâté
Passait, laissant toujours de ses mains mal fermées
Neiger de blancs bouquets d'étoiles parfumées.
Stéphane Mallarmé, Apparition
Pieyre- Messages : 20908
Date d'inscription : 17/03/2012
Localisation : Quartier Latin
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
bonjour.
Merci pour ta liste Alphonsine.
Merci pour ta liste Alphonsine.
Nochéry- Messages : 32
Date d'inscription : 11/10/2014
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Litchee 
Pour changer un peu, un poème en prose de Gabriel de Lautrec, Les Maîtresses des poètes :
Pour changer un peu, un poème en prose de Gabriel de Lautrec, Les Maîtresses des poètes :
Les maîtresses des poètes sont maigres ; c’est les femmes au corps d’enfant, qui, dès l’aube, tandis que du lourd sommeil de la nuit finissante dort l’aimé, se lèvent dans les lueurs crépusculaires. Elles vont par la chambre étroite, allumant le feu, disposant les feuilles blanches où doit se recueillir la pensée du poète, et les chers livres trop lus, qui hantent ses insomnies. Elles ont froid, malgré le feu vite allumé, étant de celles qui rêvent anxieusement être ensevelies dans les douces tiédeurs du lit, et dormir, dormir pour toujours, caressantes et caressées, cheveux noirs, front pensif, lèvres frémissantes, avec l’ignorance craintive de tout ce qui n’est pas le baiser. Et le matin, tôt levées, vigilantes, mais les yeux lourds, elles viennent se pencher éperdûment sur les yeux fermés de l’aimé, comme, dans les vieilles légendes allemandes, le page de velours noir qui veille sur le page blanc malade d’amour. Les maîtresses des poètes sont laides, mais leur laideur est pleine d’un charme à faire pleurer. Leurs prunelles ont un mystère, et leurs lèvres, le divin sourire qui humilie la beauté. Et pour telle que méprisèrent les désirs vulgaires, le poète sentit la source de son cœur blessé s’ouvrir ; et l’éternelle chanson, comme sur les cordes fragiles d’un violon sonore, pleure sa vibrante harmonie en leur âme désolée. Ô séduisantes et mélancoliques bien-aimées, quel démon subtil et triste leur enseigna le cher secret de guérir le mal de vivre par le mal d’aimer ? – Hélas ! c’est d’une que d’autres, peut-être, trouvèrent étrange, que le poète se meurt aujourd’hui, ô sœur de jadis et pauvre enfant pâme dont si frêle fut le cœur, si caressants les cheveux longs, et pour si longtemps inoubliable le frisson des yeux ! Les maîtresses des poètes sont mortes. Durant leur vie terrestre, si courte, elles s’appelèrent Lilith, Antigone, Sperata ! – et c’est d’elles, les mortes d’amour, que nous cherchons le baiser sur les lèvres d’aujourd’hui. Oh ! que la blessure est éternelle ! – Ne pouvoir guérir de ce désir d’étoile, inutile et vain, – et si cher ! – Vienne le soir qui calme et berce les cœurs malades, comme l’on berce les enfants peu sages qui voient des formes effrayantes la nuit. – Et vous endormirez l’âme du poète avec des éthers et des narcotiques, qu’il repose du sommeil sans rêve où toute douleur s’anéantit. Mais avant que descende cette aube sombre, il s’en ira sous la lune, vers les tombes où sont des lèvres closes et des yeux à jamais fermés. Et quand il aura confié au silence magique et frissonnant du soir le secret des chères paroles, et des poèmes lumineux que nul autre que lui ne lira, elles viendront, celles d’autrefois, qui seules l’auront écouté, elles viendront, avec des caresses et leurs cheveux dénoués, lui murmurer les réponses amoureuses qu’il n’avait jamais entendues, et que pourtant il reconnaîtra.
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Quand j´étais gosse, haut comme trois pommes
J´parlais bien fort pour être un homme
J´disais : je sais, je sais, je sais, je sais
C´était l´début, c´était l´printemps
Mais quand j´ai eu mes dix-huit ans
J´ai dit : je sais, ça y est, cette fois, je sais
Et aujourd´hui, les jours où je m´retourne
J´regarde la Terre où j´ai quand même fait les cent pas
Et je n´sais toujours pas comment elle tourne!
Vers vingt-cinq ans, j´savais tout : l´amour, les roses, la vie, les sous
Tiens oui l´amour! J´en avais fait tout l´tour!
Mais heureusement, comme les copains, j´avais pas mangé tout mon pain :
Au milieu de ma vie, j´ai encore appris.
C´que j´ai appris, ça tient en trois, quatre mots :
Le jour où quelqu´un vous aime, il fait très beau
J´peux pas mieux dire : il fait très beau!
C´est encore ce qui m´étonne dans la vie
Moi qui suis à l´automne de ma vie
On oublie tant de soirs de tristesse
Mais jamais un matin de tendresse!
Toute ma jeunesse, j´ai voulu dire "je sais"
Seulement, plus je cherchais, et puis moins j´savais
Il y a soixante coups qui ont sonné à l´horloge
J´suis encore à ma fenêtre, je regarde, et j´m´interroge :
Maintenant je sais, je sais qu´on n´sait jamais!
La vie, l´amour, l´argent, les amis et les roses
On n´sait jamais le bruit ni la couleur des choses
C´est tout c´que j´sais! Mais ça, j´le sais!
Jean GABIN
J´parlais bien fort pour être un homme
J´disais : je sais, je sais, je sais, je sais
C´était l´début, c´était l´printemps
Mais quand j´ai eu mes dix-huit ans
J´ai dit : je sais, ça y est, cette fois, je sais
Et aujourd´hui, les jours où je m´retourne
J´regarde la Terre où j´ai quand même fait les cent pas
Et je n´sais toujours pas comment elle tourne!
Vers vingt-cinq ans, j´savais tout : l´amour, les roses, la vie, les sous
Tiens oui l´amour! J´en avais fait tout l´tour!
Mais heureusement, comme les copains, j´avais pas mangé tout mon pain :
Au milieu de ma vie, j´ai encore appris.
C´que j´ai appris, ça tient en trois, quatre mots :
Le jour où quelqu´un vous aime, il fait très beau
J´peux pas mieux dire : il fait très beau!
C´est encore ce qui m´étonne dans la vie
Moi qui suis à l´automne de ma vie
On oublie tant de soirs de tristesse
Mais jamais un matin de tendresse!
Toute ma jeunesse, j´ai voulu dire "je sais"
Seulement, plus je cherchais, et puis moins j´savais
Il y a soixante coups qui ont sonné à l´horloge
J´suis encore à ma fenêtre, je regarde, et j´m´interroge :
Maintenant je sais, je sais qu´on n´sait jamais!
La vie, l´amour, l´argent, les amis et les roses
On n´sait jamais le bruit ni la couleur des choses
C´est tout c´que j´sais! Mais ça, j´le sais!
Jean GABIN

poupée BB- Messages : 1088
Date d'inscription : 22/08/2012
Age : 58
Localisation : picardie
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
@ Subrisio Saltat. Je peux te demander qui lit l'élégie de Duino sur le lien que tu as mis??
(Rilke, un de mes essentiels, oui! Merci à toi!)
(Rilke, un de mes essentiels, oui! Merci à toi!)

ΣΦ- Messages : 210
Date d'inscription : 13/03/2013
Localisation : ici même
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
ΣΦ a écrit:@ Subrisio Saltat. Je peux te demander qui lit l'élégie de Duino sur le lien que tu as mis??
(Rilke, un de mes essentiels, oui! Merci à toi!)
Un donneur de voix amateur bien que très doué à mon avis) dont le nom figure ici http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/rilke-rainer-maria-elegies-de-duino.html (je ne le citerai pas ici pour des raisons que tu comprendras).
Il y lit toutes les Elegies
(Sauf celle-ci, écrite pour Marina Tsvetaeva http://www.poesie.net/enfants/rilke_marina.htm . J'aimerai un jour trouver une traduction qui lui rende vraiment justice.)
Beaucoup d'amateurs de Rilke ici, c'est fou. Rilke semble avoir une certaine résonance dans le cœur ou dans la tête des membres de ce forum.
(Et merci à toi !)

Subrisio Saltat.- Messages : 174
Date d'inscription : 25/08/2014
Age : 37
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
merci Subrisio Saltat. 
j'irai jeter une oreille plus avant sur ce site qui m'a l'air bien!
Oui, difficile de traduire Rilke et Zvetaeva aussi, d'ailleurs!
Sans doute, connais-tu Laurent Terzieff, alors?
j'irai jeter une oreille plus avant sur ce site qui m'a l'air bien!
Oui, difficile de traduire Rilke et Zvetaeva aussi, d'ailleurs!
Sans doute, connais-tu Laurent Terzieff, alors?

ΣΦ- Messages : 210
Date d'inscription : 13/03/2013
Localisation : ici même
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
@ Zofie : Terzieff (RIP), le Lucernaire, le TNP toussa  !!!
!!!
Merci à toi, aujourd'hui je me sens revigorée par certains posts qui rappellent à mon souvenir tant de talents ...
 !!!
!!!Merci à toi, aujourd'hui je me sens revigorée par certains posts qui rappellent à mon souvenir tant de talents ...
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
lui-même, oui, que j'ai eu la chance de voir et d'écouter plusieurs fois, oui!
tant mieux, tant mieux (pour le "revig-orage", j'veux dire), tu m'en refiles un ch'touille???
tant mieux, tant mieux (pour le "revig-orage", j'veux dire), tu m'en refiles un ch'touille???

ΣΦ- Messages : 210
Date d'inscription : 13/03/2013
Localisation : ici même
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
ΣΦ a écrit:lui-même, oui, que j'ai eu la chance de voir et d'écouter plusieurs fois, oui!
tant mieux, tant mieux (pour le "revig-orage", j'veux dire), tu m'en refiles un ch'touille???
je te refile même toute ma ch'touille si ça peut aider !!!

petite veinarde, jamais vu en scène ce bonhomme ...
- Revis Igor !:
- Le petit plaisir du jour autre que Terzieff : Monsieur Allain Leprest
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Hey! Merci beaucoup!! C'est vrai qu'elle est très belle celle-là aussi! Tanti Grazie!

ΣΦ- Messages : 210
Date d'inscription : 13/03/2013
Localisation : ici même
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
http://www.espritsnomades.com/sitelitterature/jozsefattila/attilajozsef.html
Nochéry- Messages : 32
Date d'inscription : 11/10/2014
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
WaterShed a écrit:Un classique, mais qui me tire presque des larmes:Victor Hugo a écrit:Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin
De venir dans ma chambre un peu chaque matin ;
Je l’attendais ainsi qu’un rayon qu’on espère ;
Elle entrait et disait : « Bonjour, mon petit père » ;
Prenait ma plume, ouvrait mes livres s’asseyait
Sur mon lit, dérangeait mes papiers, et riait,
Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe.
Alors, je reprenais, la tête un peu moins lasse,
Mon oeuvre interrompue, et, tout en écrivant,
Parmi mes manuscrits je rencontrais souvent
Quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée,
Et mainte page blanche entre ses mains froissée
Où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers.
Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts,
Et c'était un esprit avant d'être une femme.
Son regard reflétait la clarté de son âme.
Elle me consultait sur tout à tous moments.
Oh! que de soirs d'hiver radieux et charmants
Passés à raisonner langue, histoire et grammaire,
Mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur mère
Tout près, quelques amis causant au coin du feu !
J'appelais cette vie être content de peu !
Et dire qu'elle est morte! hélas! que Dieu m'assiste !
Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste ;
J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux
Si j'avais, en partant, vu quelque ombre en ses yeux.
Et aussi celui-ci, d'un poète brésilien, dit par le prêtre aux obsèques d'un camarade de promotion décidé à l'automne dernier...Adémar de Barros a écrit:J'ai fait un rêve, la nuit de Noël.
Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur.
Nos pas se dessinaient sur le sable en laissant une double empreinte, la mienne et celle du Seigneur.
L'idée me vint, c'était en songe, que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie.
Je me suis arrêté pour regarder en arrière.
J'ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin.
Mais je remarquai qu'en certains endroits, au lieu de deux empreintes, il n'y en avait qu'une.
J'ai revu le film de ma vie. Ô surprise !
Les lieux à l'empreinte unique correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence.
Jours d'angoisse ou de mauvais vouloir,
Jours d'égoïsme ou de mauvaise humeur,
Jours d'épreuve et de doute,
Jours intenables...
Jours où moi aussi j'avais été intenable.
Alors me tournant vers le Seigneur,
J'osai lui faire des reproches :
"Tu nous avais pourtant promis d'être avec nous tous les jours !
Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse ?
Pourquoi m'avoir laissé seul aux pires moments de ma vie ?
Aux jours où j'avais le plus besoin de Ta présence ?"
Mais le Seigneur m'a répondu :
"Mon ami,
Les jours où tu ne vois qu'une trace de pas sur le sable, ce sont les jours où je t'ai porté !"
Je suis plus sensible au poème d'Hugo, l'autre me semble plus alambiqué, sympathique aussi, mais je ne crois pas au dieu des prètres. Celui d'Hugo me convient déjà mieux.
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
- Gaspard Hauser chante :
Je suis venu, calme orphelin,
Riche de mes seuls yeux tranquilles,
Vers les hommes des grandes villes :
Ils ne m'ont pas trouvé malin.
A vingt ans un trouble nouveau,
Sous le nom d'amoureuses flammes,
M'a fait trouver belles les femmes :
Elles ne m'ont pas trouvé beau.
Bien que sans patrie et sans roi
Et très brave ne l'étant guère,
J'ai voulu mourir à la guerre :
La mort n'a pas voulu de moi.
Suis‑ je né trop tôt ou trop tard ?
Qu'est‑ce que je fais en ce monde ?
Ô vous tous, ma peine est profonde :
Priez pour le pauvre Gaspard !
— Paul Verlaine, Sagesse
Pieyre- Messages : 20908
Date d'inscription : 17/03/2012
Localisation : Quartier Latin
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Ceux-là dont les manteaux ont des plis de linceuls
Goûtent la volupté divine d’être seuls.
Leur sagesse a pitié de l’ivresse des couples,
De l’étreinte des mains, des pas aux rythmes souples.
Ceux dont le front se cache en l’ombre des linceuls
Savent la volupté divine d’être seuls.
Ils contemplent l’aurore et l’aspect de la vie
Sans horreur, et plus d’un qui les plaint les envie.
Ceux qui cherchent la paix du soir et des linceuls
Connaissent la terrible ivresse d’être seuls.
Ce sont les bien-aimés du soir et du mystère.
Ils écoutent germer les roses sous la terre
Et perçoivent l’écho des couleurs, le reflet
Des sons… Leur atmosphère est d’un gris violet.
Ils goûtent la saveur du vent et des ténèbres,
Et leurs yeux sont plus beaux que des torches funèbres.
Renée Vivien, Les solitaires
Goûtent la volupté divine d’être seuls.
Leur sagesse a pitié de l’ivresse des couples,
De l’étreinte des mains, des pas aux rythmes souples.
Ceux dont le front se cache en l’ombre des linceuls
Savent la volupté divine d’être seuls.
Ils contemplent l’aurore et l’aspect de la vie
Sans horreur, et plus d’un qui les plaint les envie.
Ceux qui cherchent la paix du soir et des linceuls
Connaissent la terrible ivresse d’être seuls.
Ce sont les bien-aimés du soir et du mystère.
Ils écoutent germer les roses sous la terre
Et perçoivent l’écho des couleurs, le reflet
Des sons… Leur atmosphère est d’un gris violet.
Ils goûtent la saveur du vent et des ténèbres,
Et leurs yeux sont plus beaux que des torches funèbres.
Renée Vivien, Les solitaires

Elther- Messages : 60
Date d'inscription : 30/03/2013
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
On a jamais le temps
de se demander pourquoi,
pourquoi toi et moi
on est comme ça...
Si on a pas de temps,
alors il faut en prendre,
en prendre où il y en a
et ne jamais le rendre.
Si les maîtres du temps
nous déclarent la guerre,
plutôt que de le rendre,
il faudra bien la faire...
Et si ça prend du temps,
c'est pas du temps perdu
parce que s'ils nous reprennent
on sera tous pendus
Aux plus hautes
horloges
du navire...
Bibi, mézigue, alias ma pomme, il suo molto umile e obediente schiavo.
de se demander pourquoi,
pourquoi toi et moi
on est comme ça...
Si on a pas de temps,
alors il faut en prendre,
en prendre où il y en a
et ne jamais le rendre.
Si les maîtres du temps
nous déclarent la guerre,
plutôt que de le rendre,
il faudra bien la faire...
Et si ça prend du temps,
c'est pas du temps perdu
parce que s'ils nous reprennent
on sera tous pendus
Aux plus hautes
horloges
du navire...
Bibi, mézigue, alias ma pomme, il suo molto umile e obediente schiavo.
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Les bijoux. Charles Baudelaire
La très chère était nue, et, connaissant mon coeur,
Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores,
Dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur
Qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des Mores.
Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur,
Ce monde rayonnant de métal et de pierre
Me ravit en extase, et j'aime à la fureur
Les choses où le son se mêle à la lumière.
Elle était donc couchée et se laissait aimer,
Et du haut du divan elle souriait d'aise
A mon amour profond et doux comme la mer,
Qui vers elle montait comme vers sa falaise.
Les yeux fixés sur moi, comme un tigre dompté,
D'un air vague et rêveur elle essayait des poses,
Et la candeur unie à la lubricité
Donnait un charme neuf à ses métamorphoses;
Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins,
Polis comme de l'huile, onduleux comme un signe,
Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins;
Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne,
S'avançaient, plus câlins que les anges du mal,
Pour troubler le repos où mon âme était mise,
Et pour la déranger du rocher de cristal
Où, calme et solitaire, elle s'était assise.
Je croyait voir unis par un nouveau dessin
Les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe,
Tant sa taille faisait ressortir son bassin.
Sur ce teint fauve et brun le fard était superbe!
- Et la lampe s'étant résignée à mourir,
Commme le foyer seul illuminait la chambre,
Chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir,
Il inondait de sang cette peau couleur d'ambre!
La très chère était nue, et, connaissant mon coeur,
Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores,
Dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur
Qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des Mores.
Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur,
Ce monde rayonnant de métal et de pierre
Me ravit en extase, et j'aime à la fureur
Les choses où le son se mêle à la lumière.
Elle était donc couchée et se laissait aimer,
Et du haut du divan elle souriait d'aise
A mon amour profond et doux comme la mer,
Qui vers elle montait comme vers sa falaise.
Les yeux fixés sur moi, comme un tigre dompté,
D'un air vague et rêveur elle essayait des poses,
Et la candeur unie à la lubricité
Donnait un charme neuf à ses métamorphoses;
Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins,
Polis comme de l'huile, onduleux comme un signe,
Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins;
Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne,
S'avançaient, plus câlins que les anges du mal,
Pour troubler le repos où mon âme était mise,
Et pour la déranger du rocher de cristal
Où, calme et solitaire, elle s'était assise.
Je croyait voir unis par un nouveau dessin
Les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe,
Tant sa taille faisait ressortir son bassin.
Sur ce teint fauve et brun le fard était superbe!
- Et la lampe s'étant résignée à mourir,
Commme le foyer seul illuminait la chambre,
Chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir,
Il inondait de sang cette peau couleur d'ambre!

Kodiak- Messages : 1904
Date d'inscription : 05/11/2013
Age : 61
Localisation : Nice
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
- El Desdichado
Je suis le Ténébreux, le Veuf, – l'Inconsolé,
Le Prince d'Aquitaine à la Tour abolie :
Ma seule Etoile est morte, – et mon luth constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.
Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m'as consolé,
Rends‑moi le Pausilippe et la mer d'Italie,
La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé,
Et la treille où le Pampre à la Rose s'allie.
Suis‑je Amour ou Phœbus ?... Lusignan ou Biron ?
Mon front est rouge encor du baiser de la Reine;
J'ai rêvé dans la Grotte où nage la Syrène...
Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron :
Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée
Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée.
— Gérard de Nerval, Les chimères
Pieyre- Messages : 20908
Date d'inscription : 17/03/2012
Localisation : Quartier Latin
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
J'aime murmurer ce long poème comme une litanie:
La marche à l'amour
Tu as les yeux pers des champs de rosées
tu as des yeux d'aventure et d'années-lumière
la douceur du fond des brises au mois de mai
dans les accompagnements de ma vie en friche
avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif
moi qui suis charpente et beaucoup de fardoches
moi je fonce à vive allure et entêté d'avenir
la tête en bas comme un bison dans son destin
la blancheur des nénuphars s'élève jusqu'à ton cou
pour la conjuration de mes manitous maléfiques
moi qui ai des yeux où ciel et mer s'influencent
pour la réverbération de ta mort lointaine
avec cette tache errante de chevreuil que tu as
tu viendras tout ensoleillée d'existence
la bouche envahie par la fraîcheur des herbes
le corps mûri par les jardins oubliés
où tes seins sont devenus des envoûtements
tu te lèves, tu es l'aube dans mes bras
où tu changes comme les saisons
je te prendrai marcheur d'un pays d'haleine
à bout de misères et à bout de démesures
je veux te faire aimer la vie notre vie
t'aimer fou de racines à feuilles et grave
de jour en jour à travers nuits et gués
de moellons nos vertus silencieuses
je finirai bien par te rencontrer quelque part
bon dieu!
et contre tout ce qui me rend absent et douloureux
par le mince regard qui me reste au fond du froid
j'affirme ô mon amour que tu existes
je corrige notre vie
nous n'irons plus mourir de langueur
à des milles de distance dans nos rêves bourrasques
des filets de sang dans la soif craquelée de nos lèvres
les épaules baignées de vols de mouettes
non
j'irai te chercher nous vivrons sur la terre
la détresse n'est pas incurable qui fait de moi
une épave de dérision, un ballon d'indécence
un pitre aux larmes d'étincelles et de lésions profondes
frappe l'air et le feu de mes soifs
coule-moi dans tes mains de ciel de soie
la tête la première pour ne plus revenir
si ce n'est pour remonter debout à ton flanc
nouveau venu de l'amour du monde
constelle-moi de ton corps de voie lactée
même si j'ai fait de ma vie dans un plongeon
une sorte de marais, une espèce de rage noire
si je fus cabotin, concasseur de désespoir
j'ai quand même idée farouche
de t'aimer pour ta pureté
de t'aimer pour une tendresse que je n'ai pas connue
dans les giboulées d'étoiles de mon ciel
l'éclair s'épanouit dans ma chair
je passe les poings durs au vent
j'ai un coeur de mille chevaux-vapeur
j'ai un coeur comme la flamme d'une chandelle
toi tu as la tête d'abîme douce n'est-ce pas
la nuit de saule dans tes cheveux
un visage enneigé de hasards et de fruits
un regard entretenu de sources cachées
et mille chants d'insectes dans tes veines
et mille pluies de pétales dans tes caresses
tu es mon amour
ma clameur mon bramement
tu es mon amour ma ceinture fléchée d'univers
ma danse carrée des quatre coins d'horizon
le rouet des écheveaux de mon espoir
tu es ma réconciliation batailleuse
mon murmure de jours à mes cils d'abeille
mon eau bleue de fenêtre
dans les hauts vols de buildings
mon amour
de fontaines de haies de ronds-points de fleurs
tu es ma chance ouverte et mon encerclement
à cause de toi
mon courage est un sapin toujours vert
et j'ai du chiendent d'achigan plein l'âme
tu es belle de tout l'avenir épargné
d'une frêle beauté soleilleuse contre l'ombre
ouvre-moi tes bras que j'entre au port
et mon corps d'amoureux viendra rouler
sur les talus du mont Royal
orignal, quand tu brames orignal
coule-moi dans ta plainte osseuse
fais-moi passer tout cabré tout empanaché
dans ton appel et ta détermination
Montréal est grand comme un désordre universel
tu es assise quelque part avec l'ombre et ton coeur
ton regard vient luire sur le sommeil des colombes
fille dont le visage est ma route aux réverbères
quand je plonge dans les nuits de sources
si jamais je te rencontre fille
après les femmes de la soif glacée
je pleurerai te consolerai
de tes jours sans pluies et sans quenouilles
des circonstances de l'amour dénoué
j'allumerai chez toi les phares de la douceur
nous nous reposerons dans la lumière
de toutes les mers en fleurs de manne
puis je jetterai dans ton corps le vent de mon sang
tu seras heureuse fille heureuse
d'être la femme que tu es dans mes bras
le monde entier sera changé en toi et moi
la marche à l'amour s'ébruite en un voilier
de pas voletant par les lacs de portage
mes absolus poings
ah violence de délices et d'aval
j'aime
que j'aime
que tu t'avances
ma ravie
frileuse aux pieds nus sur les frimas de l'aube
par ce temps profus d'épilobes en beauté
sur ces grèves où l'été
pleuvent en longues flammèches les cris des pluviers
harmonica du monde lorsque tu passes et cèdes
ton corps tiède de pruche à mes bras pagayeurs
lorsque nous gisons fleurant la lumière incendiée
et qu'en tangage de moisson ourlée de brises
je me déploie sur ta fraîche chaleur de cigale
je roule en toi
tous les saguenays d'eau noire de ma vie
je fais naître en toi
les frénésies de frayères au fond du coeur d'outaouais
puis le cri de l'engoulevent vient s'abattre dans ta gorge
terre meuble de l'amour ton corps
se soulève en tiges pêle-mêle
je suis au centre du monde tel qu'il gronde en moi
avec la rumeur de mon âme dans tous les coins
je vais jusqu'au bout des comètes de mon sang
haletant
harcelé de néant
et dynamité
de petites apocalypses
les deux mains dans les furies dans les féeries
ô mains
ô poings
comme des cogneurs de folles tendresses
mais que tu m'aimes et si tu m'aimes
s'exhalera le froid natal de mes poumons
le sang tournera ô grand cirque
je sais que tout mon amour
sera retourné comme un jardin détruit
qu'importe je serai toujours si je suis seul
cet homme de lisière à bramer ton nom
éperdument malheureux parmi les pluies de trèfles
mon amour ô ma plainte
de merle-chat dans la nuit buissonneuse
ô fou feu froid de la neige
beau sexe léger ô ma neige
mon amour d'éclairs lapidée
morte
dans le froid des plus lointaines flammes
puis les années m'emportent sens dessus dessous
je m'en vais en délabre au bout de mon rouleau
des voix murmurent les récits de ton domaine
à part moi je me parle
que vais-je devenir dans ma force fracassée
ma force noire du bout de mes montagnes
pour te voir à jamais je déporte mon regard
je me tiens aux écoutes des sirènes
dans la longue nuit effilée du clocher de Saint-Jacques
et parmi ces bouts de temps qui halètent
me voici de nouveau campé dans ta légende
tes grands yeux qui voient beaucoup de cortèges
les chevaux de bois de tes rires
tes yeux de paille et d'or
seront toujours au fond de mon coeur
et ils traverseront les siècles
je marche à toi, je titube à toi, je meurs de toi
lentement je m'affale de tout mon long dans l'âme
je marche à toi, je titube à toi, je bois
à la gourde vide du sens de la vie
à ces pas semés dans les rues sans nord ni sud
à ces taloches de vent sans queue et sans tête
je n'ai plus de visage pour l'amour
je n'ai plus de visage pour rien de rien
parfois je m'assois par pitié de moi
j'ouvre mes bras à la croix des sommeils
mon corps est un dernier réseau de tics amoureux
avec à mes doigts les ficelles des souvenirs perdus
je n'attends pas à demain je t'attends
je n'attends pas la fin du monde je t'attends
dégagé de la fausse auréole de ma vie
Gaston Miron (L'Homme Rapaillé, Montréal, l'Hexagone, 1994)
La marche à l'amour
Tu as les yeux pers des champs de rosées
tu as des yeux d'aventure et d'années-lumière
la douceur du fond des brises au mois de mai
dans les accompagnements de ma vie en friche
avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif
moi qui suis charpente et beaucoup de fardoches
moi je fonce à vive allure et entêté d'avenir
la tête en bas comme un bison dans son destin
la blancheur des nénuphars s'élève jusqu'à ton cou
pour la conjuration de mes manitous maléfiques
moi qui ai des yeux où ciel et mer s'influencent
pour la réverbération de ta mort lointaine
avec cette tache errante de chevreuil que tu as
tu viendras tout ensoleillée d'existence
la bouche envahie par la fraîcheur des herbes
le corps mûri par les jardins oubliés
où tes seins sont devenus des envoûtements
tu te lèves, tu es l'aube dans mes bras
où tu changes comme les saisons
je te prendrai marcheur d'un pays d'haleine
à bout de misères et à bout de démesures
je veux te faire aimer la vie notre vie
t'aimer fou de racines à feuilles et grave
de jour en jour à travers nuits et gués
de moellons nos vertus silencieuses
je finirai bien par te rencontrer quelque part
bon dieu!
et contre tout ce qui me rend absent et douloureux
par le mince regard qui me reste au fond du froid
j'affirme ô mon amour que tu existes
je corrige notre vie
nous n'irons plus mourir de langueur
à des milles de distance dans nos rêves bourrasques
des filets de sang dans la soif craquelée de nos lèvres
les épaules baignées de vols de mouettes
non
j'irai te chercher nous vivrons sur la terre
la détresse n'est pas incurable qui fait de moi
une épave de dérision, un ballon d'indécence
un pitre aux larmes d'étincelles et de lésions profondes
frappe l'air et le feu de mes soifs
coule-moi dans tes mains de ciel de soie
la tête la première pour ne plus revenir
si ce n'est pour remonter debout à ton flanc
nouveau venu de l'amour du monde
constelle-moi de ton corps de voie lactée
même si j'ai fait de ma vie dans un plongeon
une sorte de marais, une espèce de rage noire
si je fus cabotin, concasseur de désespoir
j'ai quand même idée farouche
de t'aimer pour ta pureté
de t'aimer pour une tendresse que je n'ai pas connue
dans les giboulées d'étoiles de mon ciel
l'éclair s'épanouit dans ma chair
je passe les poings durs au vent
j'ai un coeur de mille chevaux-vapeur
j'ai un coeur comme la flamme d'une chandelle
toi tu as la tête d'abîme douce n'est-ce pas
la nuit de saule dans tes cheveux
un visage enneigé de hasards et de fruits
un regard entretenu de sources cachées
et mille chants d'insectes dans tes veines
et mille pluies de pétales dans tes caresses
tu es mon amour
ma clameur mon bramement
tu es mon amour ma ceinture fléchée d'univers
ma danse carrée des quatre coins d'horizon
le rouet des écheveaux de mon espoir
tu es ma réconciliation batailleuse
mon murmure de jours à mes cils d'abeille
mon eau bleue de fenêtre
dans les hauts vols de buildings
mon amour
de fontaines de haies de ronds-points de fleurs
tu es ma chance ouverte et mon encerclement
à cause de toi
mon courage est un sapin toujours vert
et j'ai du chiendent d'achigan plein l'âme
tu es belle de tout l'avenir épargné
d'une frêle beauté soleilleuse contre l'ombre
ouvre-moi tes bras que j'entre au port
et mon corps d'amoureux viendra rouler
sur les talus du mont Royal
orignal, quand tu brames orignal
coule-moi dans ta plainte osseuse
fais-moi passer tout cabré tout empanaché
dans ton appel et ta détermination
Montréal est grand comme un désordre universel
tu es assise quelque part avec l'ombre et ton coeur
ton regard vient luire sur le sommeil des colombes
fille dont le visage est ma route aux réverbères
quand je plonge dans les nuits de sources
si jamais je te rencontre fille
après les femmes de la soif glacée
je pleurerai te consolerai
de tes jours sans pluies et sans quenouilles
des circonstances de l'amour dénoué
j'allumerai chez toi les phares de la douceur
nous nous reposerons dans la lumière
de toutes les mers en fleurs de manne
puis je jetterai dans ton corps le vent de mon sang
tu seras heureuse fille heureuse
d'être la femme que tu es dans mes bras
le monde entier sera changé en toi et moi
la marche à l'amour s'ébruite en un voilier
de pas voletant par les lacs de portage
mes absolus poings
ah violence de délices et d'aval
j'aime
que j'aime
que tu t'avances
ma ravie
frileuse aux pieds nus sur les frimas de l'aube
par ce temps profus d'épilobes en beauté
sur ces grèves où l'été
pleuvent en longues flammèches les cris des pluviers
harmonica du monde lorsque tu passes et cèdes
ton corps tiède de pruche à mes bras pagayeurs
lorsque nous gisons fleurant la lumière incendiée
et qu'en tangage de moisson ourlée de brises
je me déploie sur ta fraîche chaleur de cigale
je roule en toi
tous les saguenays d'eau noire de ma vie
je fais naître en toi
les frénésies de frayères au fond du coeur d'outaouais
puis le cri de l'engoulevent vient s'abattre dans ta gorge
terre meuble de l'amour ton corps
se soulève en tiges pêle-mêle
je suis au centre du monde tel qu'il gronde en moi
avec la rumeur de mon âme dans tous les coins
je vais jusqu'au bout des comètes de mon sang
haletant
harcelé de néant
et dynamité
de petites apocalypses
les deux mains dans les furies dans les féeries
ô mains
ô poings
comme des cogneurs de folles tendresses
mais que tu m'aimes et si tu m'aimes
s'exhalera le froid natal de mes poumons
le sang tournera ô grand cirque
je sais que tout mon amour
sera retourné comme un jardin détruit
qu'importe je serai toujours si je suis seul
cet homme de lisière à bramer ton nom
éperdument malheureux parmi les pluies de trèfles
mon amour ô ma plainte
de merle-chat dans la nuit buissonneuse
ô fou feu froid de la neige
beau sexe léger ô ma neige
mon amour d'éclairs lapidée
morte
dans le froid des plus lointaines flammes
puis les années m'emportent sens dessus dessous
je m'en vais en délabre au bout de mon rouleau
des voix murmurent les récits de ton domaine
à part moi je me parle
que vais-je devenir dans ma force fracassée
ma force noire du bout de mes montagnes
pour te voir à jamais je déporte mon regard
je me tiens aux écoutes des sirènes
dans la longue nuit effilée du clocher de Saint-Jacques
et parmi ces bouts de temps qui halètent
me voici de nouveau campé dans ta légende
tes grands yeux qui voient beaucoup de cortèges
les chevaux de bois de tes rires
tes yeux de paille et d'or
seront toujours au fond de mon coeur
et ils traverseront les siècles
je marche à toi, je titube à toi, je meurs de toi
lentement je m'affale de tout mon long dans l'âme
je marche à toi, je titube à toi, je bois
à la gourde vide du sens de la vie
à ces pas semés dans les rues sans nord ni sud
à ces taloches de vent sans queue et sans tête
je n'ai plus de visage pour l'amour
je n'ai plus de visage pour rien de rien
parfois je m'assois par pitié de moi
j'ouvre mes bras à la croix des sommeils
mon corps est un dernier réseau de tics amoureux
avec à mes doigts les ficelles des souvenirs perdus
je n'attends pas à demain je t'attends
je n'attends pas la fin du monde je t'attends
dégagé de la fausse auréole de ma vie
Gaston Miron (L'Homme Rapaillé, Montréal, l'Hexagone, 1994)

Mika2- Messages : 322
Date d'inscription : 01/01/2015
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Mon œil s’étant fait peintre a, sur mon cœur, tracé,
Comme sur un tableau, ta divine figure;
Ce portrait pour son cadre en mon corps est placé
Et perspective est l'art majeur de la peinture.
Car à travers le peintre observez son savoir
Pour trouver en quoi ment votre fidèle image
Exposée en mon sein, boutique où l'on peut voir
Aux fenêtres vos yeux remplacer le vitrage.
Et vois de quels bienfaits les yeux comblent les yeux :
mes yeux t'ont dessiné, les tiens se sont fait glaces
Ouvertes en mon sein. Le soleil radieux
Aime à les traverser pour contempler tes grâces.
Mais les yeux de leur art excusent la valeur :
Ils peignent ce qu'ils voient sans connaître le cœur.
W.Shakespeare
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Je viens de tomber sur un poème de Raoul Ponchon, Le Nu dans le crime, qui m'a bien fait rire :
(Tiré d'un fait divers, où les deux assassins de M. Rémy s'étaient mis nus pour perpétrer leur crime)
... Quant à moi, dès que je connus
Que les assassins étaient nus,
Sans perdre une seconde,
Et de mon pas le plus léger,
J’allai chez Monsieur Bérenger,
À l’âme pudibonde.
Car notre illustre sénateur
Étant le plus grand contempteur
Du Nu, qui soit en France,
Il me semblait intéressant
D’avoir son avis entre cent,
En pareille occurrence.
Telle était donc la question :
Connaître son opinion
Sur le « Nu dans le crime »,
Sur ce Renard et son ami
Dont ce pauvre Monsieur Rémy
Avait été victime.
Dès qu’il me vit : « Les scélérats !
Fit-il – les sombres choléras !
Tenez j’en meurs de honte,
Pour mon pays, s’il est bien vrai
Que le crime fut perpétré,
Ainsi qu’on le raconte.
« Ce fin Renard et son « comtois »
Cet imbécile de Courtois,
Laissez-moi vous le dire,
Sans préjuger de leurs desseins,
Me semblent moins des assassins
Que d’ignobles satyres.
« Ils avaient – dit-on – adopté
Une complète nudité,
Pour occire leur maître ;
– Il fallait éviter le sang,
Sur leurs habits, les accusant,
Pouvant les compromettre.
« Allons donc ! Vous n’y pensez pas,
Ce serait en faire, en ce cas,
Des criminels-artistes ;
Mais non, ce sont des possédés.
C’est ce que nous appelons des
Exhibitionnistes.
« Ils n’avaient rien prémédité
Qu’une extrême impudicité...
Et c’est à mon estime,
Alors qu’ils se virent tout nus.
Atroces, hideux, saugrenus,
Qu’ils conçurent leur crime.
« Crime horrible et sans précédents !
Car ces deux misérables, dans
Leur folie ordurière,
Tout en le lardant d’un poignard,
À cet infortuné vieillard
Montrèrent leur derrière.
« Qui sait si ce n’est pas d’abord
De ce spectacle qu’il est mort ?...
À quatre-vingts ans d’âge,
Où l’on est au bout de son fil,
Soyez bien persuadé qu’il
N’en faut pas davantage.
« Enfin, tel est mon sentiment :
Il est mort de saisissement,
Ce vieillard, sans nul doute.
Oui, de saisissement – plutôt
Que des treize coups de couteau
Qu’il reçut, somme toute.
« – Pensez donc ! au coup de minuit,
Un derrière qui vous poursuit,
Terrifiant et blême !
Moi-même je mourrais... d’ennui,
En plein jour, rien qu’à voir celui
De Vénus elle-même ! »
(Tiré d'un fait divers, où les deux assassins de M. Rémy s'étaient mis nus pour perpétrer leur crime)
... Quant à moi, dès que je connus
Que les assassins étaient nus,
Sans perdre une seconde,
Et de mon pas le plus léger,
J’allai chez Monsieur Bérenger,
À l’âme pudibonde.
Car notre illustre sénateur
Étant le plus grand contempteur
Du Nu, qui soit en France,
Il me semblait intéressant
D’avoir son avis entre cent,
En pareille occurrence.
Telle était donc la question :
Connaître son opinion
Sur le « Nu dans le crime »,
Sur ce Renard et son ami
Dont ce pauvre Monsieur Rémy
Avait été victime.
Dès qu’il me vit : « Les scélérats !
Fit-il – les sombres choléras !
Tenez j’en meurs de honte,
Pour mon pays, s’il est bien vrai
Que le crime fut perpétré,
Ainsi qu’on le raconte.
« Ce fin Renard et son « comtois »
Cet imbécile de Courtois,
Laissez-moi vous le dire,
Sans préjuger de leurs desseins,
Me semblent moins des assassins
Que d’ignobles satyres.
« Ils avaient – dit-on – adopté
Une complète nudité,
Pour occire leur maître ;
– Il fallait éviter le sang,
Sur leurs habits, les accusant,
Pouvant les compromettre.
« Allons donc ! Vous n’y pensez pas,
Ce serait en faire, en ce cas,
Des criminels-artistes ;
Mais non, ce sont des possédés.
C’est ce que nous appelons des
Exhibitionnistes.
« Ils n’avaient rien prémédité
Qu’une extrême impudicité...
Et c’est à mon estime,
Alors qu’ils se virent tout nus.
Atroces, hideux, saugrenus,
Qu’ils conçurent leur crime.
« Crime horrible et sans précédents !
Car ces deux misérables, dans
Leur folie ordurière,
Tout en le lardant d’un poignard,
À cet infortuné vieillard
Montrèrent leur derrière.
« Qui sait si ce n’est pas d’abord
De ce spectacle qu’il est mort ?...
À quatre-vingts ans d’âge,
Où l’on est au bout de son fil,
Soyez bien persuadé qu’il
N’en faut pas davantage.
« Enfin, tel est mon sentiment :
Il est mort de saisissement,
Ce vieillard, sans nul doute.
Oui, de saisissement – plutôt
Que des treize coups de couteau
Qu’il reçut, somme toute.
« – Pensez donc ! au coup de minuit,
Un derrière qui vous poursuit,
Terrifiant et blême !
Moi-même je mourrais... d’ennui,
En plein jour, rien qu’à voir celui
De Vénus elle-même ! »
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
- Quand il est entré dans mon logis clos,
J'ourlais un drap lourd près de la fenêtre,
L'hiver dans les doigts, l'ombre sur le dos…
Sais-je depuis quand j'étais là sans être ?
Et je cousais, je cousais, je cousais…
– Mon cœur, qu'est-ce-que tu faisais ?
Il m'a demandé des outils à nous.
Mes pieds ont couru, si vifs dans la salle,
Qu'ils semblaient – si gais, si légers, si doux, –
Deux petits oiseaux caressant la dalle.
De-ci, de-là, j'allais, j'allais…
– Mon cœur, qu'est-ce que tu voulais ?
Il m'a demandé du beurre, du pain,
– Ma main en l'ouvrant caressait la huche –
Du cidre nouveau, j'allais, et ma main
Caressait les bols, la table, la cruche.
Deux fois, dix fois, vingt fois je les touchais…
– Mon cœur, qu'est-ce que tu cherchais ?
Il m'a fait sur tout trente-six pourquois.
J'ai parlé de tout, des poules, des chèvres,
Du froid et du chaud, des gens, et ma voix
En sortant de moi caressait mes lèvres…
Et je causais, je causais, je causais…
– Mon cœur, qu'est-ce que tu disais ?
Quand il est parti, pour finir l'ourlet
Que j'avais laissé, je me suis assise…
L'aiguille chantait, l'aiguille volait,
Mes doigts caressaient notre toile bise…
Et je cousais, je cousais, je cousais…
– Mon cœur, qu'est-ce que tu faisais ?
Marie Noël, Les Chansons et les Jours
Pieyre- Messages : 20908
Date d'inscription : 17/03/2012
Localisation : Quartier Latin
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Allégeance
Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus; qui au juste l'aima?
Il cherche son pareil dans le voeu des regards. L'espace qu'il parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger l'éconduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part.
Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. A son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse.
Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus; qui au juste l'aima et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas?
René Char
Extrait de
"Eloge d'une soupçonnée,
Poésie/Gallimard"
Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus; qui au juste l'aima?
Il cherche son pareil dans le voeu des regards. L'espace qu'il parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger l'éconduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part.
Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. A son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse.
Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus; qui au juste l'aima et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas?
René Char
Extrait de
"Eloge d'une soupçonnée,
Poésie/Gallimard"
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Frisson d'hiver de Stéphane Mallarmé (1867)
Cette pendule de Saxe, qui retarde et sonne treize heures parmi ses fleurs et ses dieux, à qui a-t-elle été ? Pense qu’elle est venue de Saxe par les longues diligences autrefois.
(De singulières ombres pendent aux vitres usées.)
Et ta glace de Venise, profonde comme une froide fontaine, en un rivage de guivres dédorées, qui s’y est miré ? Ah ! je suis sûr que plus d’une femme a baigné dans cette eau le péché de sa beauté ; et peut-être verrais-je un fantôme nu si je regardais longtemps.
— Vilain, tu dis souvent de méchantes choses.
(Je vois des toiles d’araignées au haut des grandes croisées.)
Notre bahut encore est très vieux : contemple comme ce feu rougit son triste bois ; les rideaux amortis ont son âge, et la tapisserie des fauteuils dénués de fard, et les anciennes gravures des murs, et toutes nos vieilleries ? Est-ce qu’il ne te semble pas, même, que les bengalis et l’oiseau bleu ont déteint avec le temps ?
(Ne songe pas aux toiles d’araignées qui tremblent au haut des grandes croisées.)
Tu aimes tout cela et voilà pourquoi je puis vivre auprès de toi. N’as-tu pas désiré, ma sœur au regard de jadis, qu’en un de mes poèmes apparussent ces mots « la grâce de choses fanées » ? Les objets neufs te déplaisent ; à toi aussi, ils font peur avec leur hardiesse criarde, et tu te sentirais le besoin de les user, ce qui est bien difficile à faire pour ceux qui ne goûtent pas l’action.
Viens, ferme ton vieil almanach allemand, que tu lis avec attention, bien qu’il ait paru il y a plus de cent ans et que les rois qu’il annonce soient tous morts, et, sur l’antique tapis couché, la tête appuyée parmi tes genoux charitables dans ta robe pâlie, ô calme enfant, je te parlerai pendant des heures ; il n’y a plus de champs et les rues sont vides, je te parlerai de nos meubles... Tu es distraite ?
(Ces toiles d’araignées grelottent au haut des grandes croisées.)
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Apollinaire - Automne malade
Tzara - L'Homme approximatif
Villon - Le Testament, "Les regrets de la belle Heaulmiere"
Rimbaud - Barbare
Ezra Pound - Sestina : Altaforte
Lautréamont - Les Chants de Maldoror
- Spoiler:
- Automne malade et adoré
Tu mourras quand l'ouragan soufflera dans les roseraies
Quand il aura neigé
Dans les vergers
Pauvre automne
Meurs en blancheur et en richesse
De neige et de fruits mûrs
Au fond du ciel
Des éperviers planent
Sur les nixes nicettes aux cheveux verts et naines
Qui n'ont jamais aimé
Aux lisières lointaines
Les cerfs ont bramé
Et que j'aime ô saison que j'aime tes rumeurs
Les fruits tombant sans qu'on les cueille
Le vent et la forêt qui pleurent
Toutes leurs larmes en automne feuille à feuille
Les feuilles
Qu'on foule
Un train
Qui roule
La vie
S'écoule
Tzara - L'Homme approximatif
- Spoiler:
- le temps laisse choir de petits poucets derrière lui
il fauche les fines molécules sur les prairies d'eau
il dompte les poches d'air traverse leur jungle
il coupe le ver de la vague et de chaque moitié s'illumine un papillon
dans le volcan il se faufile le long d'une note de violon
il boucle le cours filant du verre dans les fines heures de transparence
là où nos sommeils bousculent la chantante nourriture de lumière
- Spoiler:
- il y a un bien beau pays dans sa tête
là où la promesse du ciel le touche avec sa main
nue est la peau du ciel et écorchée par les grappes de rochers
les raides itinéraires des convois de ronces
ont limité de l'air les fiévreux profils
et dans la citerne de sa mémoire l'essaim des peuplades
mûries dans les perfides nivellements
désagrège l'écume haletante la raison sans issue
son maudit chavirement transit là où finit ta volupté grandit le vide
se casse l'éperon des steppes sordides contre la piste des dolmens
ventilateur raclant dans le cercueil de résonance du ravin
ravin grisé de profondeurs gémissantes
capitonné de fines écritures de vertiges dédaigneux et d'algues
nos regards glissant de verticale en verticale se dissolvent
dessinent des yeux d'huile sur leur flaque
ainsi je te regarde au pied de la montagne
assise comme la nuit est prête à se répandre
et sur les marches creuses qu'enfoncent tes allures
s'est faufilée la mort haleine d'apaisement
Villon - Le Testament, "Les regrets de la belle Heaulmiere"
- Spoiler:
- XLVII
Advis m'est que j'oy regrecter
La belle qui fut heaulmiere,
Soy jeune fille soubzhaicter
Et parler en telle maniere :
"A ! Vieillesse felonne et fiere,
Pourquoy m'as si tost abatue ?
Qui me tient, qui, que ne me fiere
Et qu'à ce coup je ne me tue ?
XLVIII
"Tolu m'as la haulte franchise
Que Beaulté m'avoit ordonné
Sur clers, marchans et gens d'Eglise,
Car lors il n'estoit homme né
Qui tout le scien ne m'eust donné,
Quoy qu'il en feust de repentailles,
Mais que lui eusse abandonné
Ce que reffusent truandailles.
XLIX
"A maint homme l'ay reffusé
- Qui n'estoit à moy grant sagesse -
Pour l'amour d'un garson rusé,
Auquel j'en feiz grande largesse.
A qui que je feisse fynesse,
Par m'ame je l'aymoye bien !
Or ne me faisoit que rudesse
Et ne m'amoit que pour le mien.
L
"Sy ne me sceust tant detrainer,
Fouller aux piez, que ne l'aymasse,
Et m'eust dit que je le baisasse,
Que tous mes maulx je n'oubliasse.
Le glouton, de mal entaichié,
M'embrassoit... J'en suis bien plus grasse !
Que m'en rest'il ? Honte... et pechié !
LI
"Or est il mort, passé trente ans,
Et je remains, vielle, chenue.
Quant je pense, lasse, au bon temps,
Que me regarde toute nue
- Quelle fuz, quelle devenue ! -,
Et je me voy si treschangée,
Povre, seiche, maigre, menue,
Je suis presque toute enraigée.
LII
"Qu'est devenu ce front poly,
Cheveux blons, ces sourciz voltiz,
Grant entreuil, ce regard joly
Dont prenoie les plus soubtilz,
Ce beau nez droit, grant ne petiz,
Ces petites joinctes orreilles,
Menton fourchu, cler viz traictiz,
Et ces belles levres vermeilles ?
LIII
"Ces gentes espaulles menues,
Ces braz longs et ces mains traictisses,
Petiz tetins, hanches charnues,
Eslevées, propres et faictisses
A tenir amoureuses lices,
Ces larges reins, ce sadinet
Assiz sur grosses fermes cuisses
Dedens son petit jardinet ?
LIV
"Le front ridé, les cheveux griz,
Les sourciz cheux, les yeulx estains,
Qui faisoient regars et ris
Dont maints meschans furent actains,
Nez courbes, de beaulté loingtaings,
Orreilles pendentes, moussues,
Le visz paly, mort et destains,
Menton froncé, levres peaussues...
LV
"- C'est d'umaine beaulté l'yssue ! -
Les braz cours et les mains contraictes,
Des espaulles toute bossue,
Mamelles, quoy ? toutes retraictes :
Telles les hanches que les tectes.
Du sadinet ? Fy ! Quant des cuisses,
Cuisses ne sont plus, mais cuissectes
Grivelées comme saulcisses.
LVI
"Ainsi le bon temps regretons
Entre nous, povres vielles soctes,
Assises bas à cruppetons,
Tout en ung tas, comme peloctes,
A petit feu de chenevoctes,
Tost alumées, tost estainctes...
Et jadiz fusmes si mignotes !
Ainsi en prent à maint et maintes."
Ballade "de la belle Heaulmiere aux filles de joie"
"Or y pensez, belle Gaultiere,
Qui escolliere souliez estre,
Et vous, Blanche la Savetiere :
Ores est temps de vous congnoistre !
Prenez à destre et à senestre,
N'espargniez homme, je vous prie,
Car vielles n'ont ne cours ne estre
Ne que monnoye qu'on descrye.
"Et vous, la gente Saulcissiere,
Qui de dancer estes adestre,
Guillemete la Tappiciere,
Ne mesprenez vers vostre maistre !
Tost vous fauldra clore fenestre :
Quant deviendrez vielle, fletrye,
Plus ne servirez q'un viel prestre
Ne que monnoye c'on descrye.
"Jehanneton la Chapperonniere,
Gardez qu'amy ne vous empestre,
Et Katherine la Bourciere,
N'envoyez plus les hommes paistre !
Car, qui belle n'est, mais leur rie :
Laide viellesse amour n'impestre
Ne que monnoye c'on descrye.
"Filles, vueilliez vous entremectre
D'escouter pourquoy pleure et crye :
Pource que je ne me puis mectre
Ne que monnoye c'on descrye."
Rimbaud - Barbare
- Spoiler:
- Bien après les jours et les saisons, et les êtres et les pays,
Le pavillon en viande saignante sur la soir des mers et des fleurs arctiques ; (elles n'existent pas)
Remis des vieilles fanfares d'héroïsme - qui nous attaquent encore le coeur et la tête - loin des anciens assassins -
Oh ! Le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques ; (elles n'existent pas)
Douceurs !
Les brasiers, pleuvant aux rafales de givre, - Douceurs ! - les feux à la pluie du vent de diamants jetée par le coeur terrestre éternellement carbonisé pour nous. - Ô monde ! -
(Loin des vieilles retraites et des vieilles flammes, qu'on entend, qu'on sent,)
Les brasiers et les écumes. La musique, virement des gouffres et choc des glaçons aux astres.
Ô Douceurs, ô monde, ô musique ! Et là, les formes, les sueurs, les chevelures et les yeux, flottant. Et les larmes blanches, bouillantes, - ô douceurs ! - et la voix féminine arrivée au fond des volcans et des grottes arctiques.
Le pavillon...
Ezra Pound - Sestina : Altaforte
- Spoiler:
- Loquitur : en Bertrans de Born.
Dante Alighieri put this man in hell for that he was a stirrer-up of strife.
Eccovi !
Judge ye !
Have I dug him up again ?
The scene in at his castle, Altaforte. "Papiols" is his jongleur.
"The Leopard", the device of Richard (Cuur de Lion)
I
Damn it all ! all this our South stinks peace.
You whoreson dog, Papiols, come ! Let's to music !
I have no life save when the swords clash.
But ah ! when I see the standards gold, vair, purple, opposing
And the broad fields beneath them turn crimson,
Then howl I my heart nigh mad with rejoicing.
II
In hot summer have I great rejoicing
When the tempests kill the earth's foul peace,
And the lightnings from black heav'n flash crimson,
And the fierce thunders roar me their music
And the winds shriek through the clouds mad, opposing,
And through all the riven skies God's swords clash.
III
Hell grant soon we hear again the swords clash !
And the shrill neighs of destriers in battle rejoicing,
Spiked breast to spiked breast opposing !
Better one hour's stour than a year's peace
With fat boards, bawds, wine and frail music !
Bah ! there's no wine like the blood's crimson !
IV
And I love to see the sun rise blood-crimson.
And I watch his spears through the dark clash
And it fills all my heart with rejoicing
And pries wide my mouth with fast music
When I see him so scorn and defy peace,
His lone might 'gainst all darkness opposing.
V
The man who fears war and squats opposing
My words for stour, hath no blood of crimson
But is fit only to rot in womanish peace
Far from where worth's won and the swords clash
For the death of such sluts I go rejoicing ;
Yea, I fill all the air with my music.
VI
Papiols, Papiols, to the music !
There's no sound like to swords swords opposing,
No cry like the battle's rejoicing
When our elbows and swords drip the crimson
And our charges 'gainst "The Leopard's" rush clash.
May God damn for ever all who cry "Peace !"
VII
And let the music of the swords make them crimson !
Hell grant soon we hear again the swords clash !
Hell blot black for always the thought "Peace !"
Lautréamont - Les Chants de Maldoror
- Chant I, strophe 9:
- Je me propose, sans être ému, de déclamer à grande voix la strophe sérieuse et froide que vous allez entendre. Vous, faites attention à ce qu’elle contient, et gardez-vous de l’impression pénible qu’elle ne manquera pas de laisser, comme une flétrissure, dans vos imaginations troublées. Ne croyez pas que je sois sur le point de mourir, car je ne suis pas encore un squelette, et la vieillesse n’est pas collée à mon front. Écartons en conséquence toute idée de comparaison avec le cygne, au moment où son existence s’envole, et ne voyez devant vous qu’un monstre, dont je suis heureux que vous ne puissiez apercevoir la figure ; mais, moins horrible est-elle que son âme. Cependant, je ne suis pas un criminel… Assez sur ce sujet. Il n’y pas longtemps que j’ai revu la mer et foulé le pont des vaisseaux, et mes souvenirs sont vivaces comme si je l’avais quittée la veille. Soyez néanmoins, si vous le pouvez, aussi calmes que moi, dans cette lecture que je me repens déjà de vous offrir, et ne rougissez pas à la pensée de ce qu’est le cœur humain. Ô poulpe, au regard de soie ! toi, dont l’âme est inséparable de la mienne ; toi, le plus beau des habitants du globe terrestre, et qui commandes à un sérail de quatre cents ventouses ; toi, en qui siègent noblement, comme dans leur résidence naturelle, par un commun accord, d’un lien indestructible, la douce vertu communicative et les grâces divines, pourquoi n’es-tu pas avec moi, ton ventre de mercure contre ma poitrine d’aluminium, assis tous les deux sur quelque rocher du rivage, pour contempler ce spectacle que j’adore !
Vieil océan, aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées que l’on voit sur le dos meurtri des mousses ; tu es un immense bleu, appliqué sur le corps de la terre : j’aime cette comparaison. Ainsi, à ton premier aspect, un souffle prolongé de tristesse, qu’on croirait être le murmure de ta brise suave, passe, en laissant des ineffaçables traces, sur l’âme profondément ébranlée, et tu rappelles au souvenir de tes amants, sans qu’on s’en rende toujours compte, les rudes commencements de l’homme, où il fait connaissance avec la douleur, qui ne le quitte plus. Je te salue, vieil océan !
Vieil océan, ta forme harmonieusement sphérique, qui réjouit la face grave de la géométrie, ne me rappelle que trop les petits yeux de l’homme, pareils à ceux du sanglier pour la petitesse, et à ceux des oiseaux de nuit pour la perfection circulaire du contour. Cependant, l’homme s’est cru beau dans tous les siècles. Moi, je suppose plutôt que l’homme ne croit à sa beauté que par amour-propre ; mais, qu’il n’est pas beau réellement et qu’il s’en doute ; car, pourquoi regarde-t-il la figure de son semblable avec tant de mépris ? Je te salue, vieil océan !
Vieil océan, tu es le symbole de l’identité : toujours égal à toi-même. Tu ne varies pas d’une manière essentielle, et, si tes vagues sont quelque part en furie, plus loin, dans quelque autre zone, elles sont dans le calme le plus complet. Tu n’es pas comme l’homme qui s’arrête dans la rue, pour voir deux boule-dogues s’empoigner au cou, mais, qui ne s’arrête pas, quand un enterrement passe ; qui est ce matin accessible et ce soir de mauvaise humeur ; qui rit aujourd’hui et pleure demain. Je te salue, vieil océan !
Vieil océan, il n’y aurait rien d’impossible à ce que tu caches dans ton sein de futures utilités pour l’homme. Tu lui as déjà donné la baleine. Tu ne laisses pas facilement deviner aux yeux avides des sciences naturelles les mille secrets de ton intime organisation : tu es modeste. L’homme se vante sans cesse, et pour des minuties. Je te salue, vieil océan !
Vieil océan, les différentes espèces de poissons que tu nourris n’ont pas juré fraternité entre elles. Chaque espèce vit de son côté. Les tempéraments et les conformations qui varient dans chacune d’elles, expliquent, d’une manière satisfaisante, ce qui ne paraît d’abord qu’une anomalie. Il en est ainsi de l’homme, qui n’a pas les mêmes motifs d’excuse. Un morceau de terre est-il occupé par trente millions d’êtres humains, ceux-ci se croient obligés de ne pas se mêler de l’existence de leurs voisins, fixés comme des racines sur le morceau de terre qui suit. En descendant du grand au petit, chaque homme vit comme un sauvage dans sa tanière, et en sort rarement pour visiter son semblable, accroupi pareillement dans une autre tanière. La grande famille universelle des humains est une utopie digne de la logique la plus médiocre. En outre, du spectacle de tes mamelles fécondes, se dégage la notion d’ingratitude ; car, on pense aussitôt à ces parents nombreux, assez ingrats envers le Créateur, pour abandonner le fruit de leur misérable union. Je te salue, vieil océan !
Vieil océan, ta grandeur matérielle ne peut se comparer qu’à la mesure qu’on se fait de ce qu’il a fallu de puissance active pour engendrer la totalité de ta masse. On ne peut pas t’embrasser d’un coup d’œil. Pour te contempler, il faut que la vue tourne son télescope, par un mouvement continu, vers les quatre points de l’horizon, de même qu’un mathématicien, afin de résoudre une équation algébrique, est obligé d’examiner séparément les divers cas possibles, avant de trancher la difficulté. L’homme mange des substances nourrissantes, et fait d’autres efforts, dignes d’un meilleur sort, pour paraître gras. Qu’elle se gonfle tant qu’elle voudra, cette adorable grenouille. Sois tranquille, elle ne t’égalera pas en grosseur ; je le suppose, du moins. Je te salue, vieil océan !
Vieil océan, tes eaux sont amères. C’est exactement le même goût que le fiel que distille la critique sur les beaux-arts, sur les sciences, sur tout. Si quelqu’un a du génie, on le fait passer pour un idiot ; si quelque autre est beau de corps, c’est un bossu affreux. Certes, il faut que l’homme sente avec force son imperfection, dont les trois quarts d’ailleurs ne sont dus qu’à lui-même, pour la critiquer ainsi ! Je te salue, vieil océan !
Vieil océan, les hommes, malgré l’excellence de leurs méthodes, ne sont pas encore parvenus, aidés par les moyens d’investigation de la science, à mesurer la profondeur vertigineuse de tes abîmes ; tu en as que les sondes les plus longues, les plus pesantes, ont reconnu inaccessibles. Aux poissons… ça leur est permis : pas aux hommes. Souvent, je me suis demandé quelle chose était le plus facile à reconnaître : la profondeur de l’océan ou la profondeur du cœur humain ! Souvent, la main portée au front, debout sur les vaisseaux, tandis que la lune se balançait entre les mâts d’une façon irrégulière, je me suis surpris, faisant abstraction de tout ce qui n’était pas le but que je poursuivais, m’efforçant de résoudre ce difficile problème ! Oui, quel est le plus profond, le plus impénétrable des deux : l’océan ou le cœur humain ? Si trente ans d’expérience de la vie peuvent jusqu’à un certain point pencher la balance vers l’une ou l’autre de ces solutions, il me sera permis de dire que, malgré la profondeur de l’océan, il ne peut pas se mettre en ligne, quant à la comparaison sur cette propriété, avec la profondeur du cœur humain. J’ai été en relation avec des hommes qui ont été vertueux. Ils mouraient à soixante ans, et chacun ne manquait pas de s’écrier : « Ils ont fait le bien sur cette terre, c’est-à-dire qu’ils ont pratiqué la charité : voilà tout, ce n’est pas malin, chacun peut en faire autant. » Qui comprendra pourquoi deux amants qui s’idolâtraient la veille, pour un mot mal interprété, s’écartent, l’un vers l’orient, l’autre vers l’occident, avec les aiguillons de la haine, de la vengeance, de l’amour et du remords, et ne se revoient plus, chacun drapé dans sa fierté solitaire. C’est un miracle qui se renouvelle chaque jour et qui n’en est pas moins miraculeux. Qui comprendra pourquoi l’on savoure non seulement les disgrâces générales de ses semblables, mais encore les particulières de ses amis les plus chers, tandis que l’ont est affligé en même temps ? Un exemple incontestable pour clore la série : l’homme dit hypocritement oui et pense non. C’est pour cela que les marcassins de l’humanité ont tant de confiance les uns dans les autres et ne sont pas égoïstes. Il reste à la psychologie beaucoup de progrès à faire. Je te salue, vieil océan !
Vieil océan, tu es si puissant, que les hommes l’ont appris à leurs propres dépens. Ils ont beau employer toutes les ressources de leur génie… incapables de te dominer. Ils ont trouvé leur maître. Je dis qu’ils ont trouvé quelque chose de plus fort qu’eux. Ce quelque chose a un nom. Ce nom est : l’océan ! La peur que tu leur inspires est telle, qu’ils te respectent. Malgré cela, tu fais valser leurs plus lourdes machines avec grâce, élégance et facilité. Tu leur fais faire des sauts gymnastiques jusqu’au ciel, et des plongeons admirables jusqu’au fond de tes domaines : un saltimbanque en serait jaloux. Bienheureux sont-ils, quand tu ne les enveloppes pas définitivement dans tes plis bouillonnants, pour aller voir, sans chemin de fer, dans tes entrailles aquatiques, comment se portent les poissons, et surtout comment ils se portent eux-mêmes. L’homme dit : « Je suis plus intelligent que l’océan. » C’est possible ; c’est même assez vrai ; mais l’océan lui est plus redoutable que lui à l’océan : c’est ce qu’il n’est pas nécessaire de prouver. Ce patriarche observateur, contemporain des premières époques de notre globe suspendu, sourit de pitié, quand il assiste aux combats navals des nations. Voilà une centaine de léviathans qui sont sortis des mains de l’humanité. Les ordres emphatiques des supérieurs, les cris des blessés, les coups de canon, c’est du bruit fait exprès pour anéantir quelques secondes. Il paraît que le drame est fini, et que l’océan a tout mis dans son ventre. La gueule est formidable. Elle doit être grande vers le bas, dans la direction de l’inconnu ! Pour couronner enfin la stupide comédie, qui n’est même pas intéressante, on voit, au milieu des airs, quelque cigogne, attardée par la fatigue, qui se met à crier, sans arrêter l’envergure de son vol : « Tiens !… je la trouve mauvaise ! Il y avait en bas des points noirs ; j’ai fermé les yeux : ils ont disparu. » Je te salue, vieil océan !
Vieil océan, ô grand célibataire, quand tu parcours la solitude solennelle de tes royaumes flegmatiques, tu t’enorgueillis à juste titre de ta magnificence native, et des éloges vrais que je m’empresse de te donner. Balancé voluptueusement par les molles effluves de ta lenteur majestueuse, qui est le plus grandiose parmi les attributs dont le souverain pouvoir t’a gratifié, tu déroules, au milieu d’un sombre mystère, sur toute ta surface sublime, tes vagues incomparables, avec le sentiment calme de ta puissance éternelle. Elles se suivent parallèlement, séparées par de courts intervalles. À peine l’une diminue, qu’une autre va à sa rencontre en grandissant, accompagnées du bruit mélancolique de l’écume qui se fond, pour nous avertir que tout est écume. (Ainsi, les êtres humains, ces vagues vivantes, meurent l’un après l’autre, d’une manière monotone ; mais, sans laisser de bruit écumeux). L’oiseau de passage se repose sur elles avec confiance, et se laisse abandonner à leurs mouvements, pleins d’une grâce fière, jusqu’à ce que les os de ses ailes aient recouvré leur vigueur accoutumée pour continuer le pèlerinage aérien. Je voudrais que la majesté humaine ne fût que l’incarnation du reflet de la tienne. Je demande beaucoup, et ce souhait sincère est glorieux pour toi. Ta grandeur morale, image de l’infini, est immense comme la réflexion du philosophe, comme l’amour de la femme, comme la beauté divine de l’oiseau, comme les méditations du poète. Tu es plus beau que la nuit. Réponds-moi, océan, veux-tu être mon frère ? Remue-toi avec impétuosité… plus… plus encore, si tu veux que je te compare à la vengeance de Dieu ; allonge tes griffes livides, en te frayant un chemin sur ton propre sein… c’est bien. Déroule tes vagues épouvantables, océan hideux, compris par moi seul, et devant lequel je tombe, prosterné à tes genoux. La majesté de l’homme est empruntée ; il ne m’imposera point : toi, oui. Oh ! quand tu t’avances, la crête haute et terrible, entouré de tes replis tortueux comme d’une cour, magnétiseur et farouche, roulant tes ondes les unes sur les autres, avec la conscience de ce que tu es, pendant que tu pousses, des profondeurs de ta poitrine, comme accablé d’un remords intense que je ne puis pas découvrir, ce sourd mugissement perpétuel que les hommes redoutent tant, même quand ils te contemplent, en sûreté, tremblants sur le rivage, alors, je vois qu’il ne m’appartient pas, le droit insigne de me dire ton égal. C’est pourquoi, en présence de ta supériorité, je te donnerais tout mon amour (et nul ne sait la quantité d’amour que contiennent mes aspirations vers le beau), si tu ne me faisais douloureusement penser à mes semblables, qui forment avec toi le plus ironique contraste, l’antithèse la plus bouffonne que l’on ait jamais vue dans la création : je ne puis pas t’aimer, je te déteste. Pourquoi reviens-je à toi, pour la millième fois, vers tes bras amis, qui s’entr’ouvrent, pour caresser mon front brûlant, qui voit disparaître la fièvre à leur contact ! Je ne connais pas ta destinée cachée ; tout ce qui te concerne m’intéresse. Dis-moi donc si tu es la demeure du prince des ténèbres. Dis-le moi… dis-le moi, océan (à moi seul, pour ne pas attrister ceux qui n’ont encore connu que les illusions), et si le souffle de Satan crée les tempêtes qui soulèvent tes eaux salées jusqu’aux nuages. Il faut que tu me le dises, parce que je me réjouirais de savoir l’enfer si près de l’homme. Je veux que celle-ci soit la dernière strophe de mon invocation. Par conséquent, une seule fois encore, je veux te saluer et te faire mes adieux ! Vieil océan, aux vagues de cristal… Mes yeux se mouillent de larmes abondantes, et je n’ai pas la force de poursuivre ; car, je sens que le moment venu de revenir parmi les hommes, à l’aspect brutal ; mais… courage ! Faisons un grand effort, et accomplissons, avec le sentiment du devoir, notre destinée sur cette terre. Je te salue, vieil océan !
- Chant III, strophe 5:
- Une lanterne rouge, drapeau du vice, suspendue à l’extrémité d’une tringle, balançait sa carcasse au fouet des quatre vents, au-dessus d’une porte massive et vermoulue. Un corridor sale, qui sentait la cuisse humaine, donnait sur un préau, où cherchaient leur pâture des coqs et des poules, plus maigres que leurs ailes. Sur la muraille qui servait d’enceinte au préau, et située du côté de l’ouest, étaient parcimonieusement pratiquées diverses ouvertures, fermées par un guichet grillé. La mousse recouvrait ce corps de logis, qui, sans doute, avait été un couvent et servait, à l’heure actuelle, avec le reste du bâtiment, comme demeure de toutes ces femmes qui montraient chaque jour, à ceux qui entraient, l’intérieur de leur vagin, en échange d’un peu d’or. J’étais sur un pont, dont les piles plongeaient dans l’eau fangeuse d’un fossé de ceinture. De sa surface élevée, je contemplais dans la campagne cette construction penchée sur sa vieillesse et les moindres détails de son architecture intérieure. Quelquefois, la grille d’un guichet s’élevait sur elle-même en grinçant, comme par l’impulsion ascendante d’une main qui violentait la nature du fer : un homme présentait sa tête à l’ouverture dégagée à moitié, avançait ses épaules, sur lesquelles tombait le plâtre écaillé, faisait suivre, dans cette extraction laborieuse, son corps couvert de toiles d’araignées. Mettant ses mains, ainsi qu’une couronne, sur les immondices de toutes sortes qui pressaient le sol de leur poids, tandis qu’il avait encore la jambe engagée dans les torsions de la grille, il reprenait ainsi sa posture naturelle, allait tremper ses mains dans un baquet boiteux, dont l’eau savonnée avait vu s’élever, tomber des générations entières, et s’éloignait ensuite, le plus vite possible, de ces ruelles faubouriennes, pour aller respirer l’air pur vers le centre de la ville. Lorsque le client était sorti, une femme toute nue se portait au dehors, de la même manière, et se dirigeait vers le même baquet. Alors, les coqs et les poules accouraient en foule des divers points du préau, attirés par l’odeur séminale, la renversaient par terre, malgré ses efforts vigoureux, trépignaient la surface de son corps comme un fumier et déchiquetaient, à coups de bec, jusqu’à ce qu’il sortît du sang, les lèvres flasques de son vagin gonflé. Les poules et les coqs, avec leur gosier rassasié, retournaient gratter l’herbe du préau ; la femme, devenue propre, se relevait, tremblante, couverte de blessures, comme lorsqu’on s’éveille après un cauchemar. Elle laissait tomber le torchon qu’elle avait apporté pour essuyer ses jambes ; n’ayant plus besoin du baquet commun, elle retournait dans sa tanière, comme elle en était sortie, pour attendre une autre pratique. À ce spectacle, moi, aussi, je voulus pénétrer dans cette maison ! J’allai descendre du pont, quand je vis, sur l’entablement d’un pilier, cette inscription, en caractères hébreux : « Vous, qui passez sur ce pont, n’y allez pas. Le crime y séjourne avec le vice ; un jour, ses amis attendirent en vain un jeune homme qui avait franchi la porte fatale. » La curiosité l’emporta sur la crainte ; au bout de quelques instants, j’arrivai devant un guichet, dont la grille possédait de solides barreaux, qui s’entre-croisaient étroitement. Je voulus regarder dans l’intérieur, à travers ce tamis épais. D’abord, je ne pus rien voir ; mais, je ne tardai pas à distinguer les objets qui étaient dans la chambre obscure, grâce aux rayons du soleil qui diminuait sa lumière et allait bientôt disparaître à l’horizon. La première et la seule chose qui frappa ma vue fut un bâton blond, composé de cornets, s’enfonçant les uns dans les autres. Ce bâton se mouvait ! Il marchait dans la chambre ! Ses secousses étaient si fortes, que le plancher chancelait ; avec ses deux bouts, il faisait des brèches énormes dans la muraille et paraissait un bélier qu’on ébranle contre la porte d’une ville assiégée. Ses efforts étaient inutiles ; les murs étaient construits avec de la pierre de taille, et, quand il choquait la paroi, je le voyais se recourber en lame d’acier et rebondir comme une balle élastique. Ce bâton n’était donc pas fait en bois ! Je remarquai, ensuite, qu’il se roulait et se déroulait avec facilité comme une anguille. Quoique haut comme un homme, il ne se tenait pas droit. Quelquefois, il l’essayait, et montrait un de ses bouts, devant le grillage du guichet. Il faisait des bonds impétueux, retombait à terre et ne pouvait défoncer l’obstacle. Je me mis à le regarder de plus en plus attentivement et je vis que c’était un cheveu ! Après une grande lutte, avec la matière qui l’entourait comme une prison, il alla s’appuyer contre le lit qui était dans cette chambre, la racine reposant sur un tapis et la pointe adossée au chevet. Après quelques instants de silence, pendant lesquels j’entendis des sanglots entrecoupés, il éleva la voix et parla ainsi : « Mon maître m’a oublié dans cette chambre ; il ne vient pas me chercher. Il s’est levé de ce lit, où je suis appuyé, il a peigné sa chevelure parfumée et n’a pas songé qu’auparavant j’étais tombé à terre. Cependant, s’il m’avait ramassé, je n’aurais pas trouvé étonnant cet acte de simple justice. Il m’abandonne, dans cette chambre claquemurée, après s’être enveloppé dans les bras d’une femme. Et quelle femme ! Les draps sont encore moites de leur contact attiédi et portent, dans leur désordre, l’empreinte d’une nuit passée dans l’amour… » Et je me demandais qui pouvait être son maître ! Et mon œil se recollait à la grille avec plus d’énergie !… « Pendant que la nature entière sommeillait dans sa chasteté, lui, il s’est accouplé avec une femme dégradée, dans des embrassements lascifs et impurs. Il s’est abaissé jusqu’à laisser approcher, de sa face auguste, des joues méprisables par leur impudence habituelle, flétries dans leur séve. Il ne rougissait pas, mais, moi, je rougissais pour lui. Il est certain qu’il se sentait heureux de dormir avec une telle épouse d’une nuit. La femme, étonnée de l’aspect majestueux de cet hôte, semblait éprouver des voluptés incomparables, lui embrassait le cou avec frénésie. » Et je me demandais qui pouvait être son maître ! Et mon œil se recollait à la grille avec plus d’énergie !… « Moi, pendant ce temps, je sentais des pustules envenimées qui croissaient plus nombreuses, en raison de son ardeur inaccoutumée pour les jouissances de la chair, entourer ma racine de leur fiel mortel, absorber, avec leurs ventouses, la substance génératrice de ma vie. Plus ils s’oubliaient, dans leurs mouvements insensés, plus je sentais mes forces décroître. Au moment où les désirs corporels atteignaient au paroxysme de la fureur, je m’aperçus que ma racine s’affaissait sur elle-même, comme un soldat blessé par une balle. Le flambeau de la vie s’étant éteint en moi, je me détachai, de sa tête illustre, comme une branche morte ; je tombai à terre, sans courage, sans force, sans vitalité ; mais, avec une profonde pitié pour celui auquel j’appartenais ; mais, avec une éternelle douleur pour son égarement volontaire !… » Et je me demandais qui pouvait être son maître ! Et mon œil se recollait à la grille avec plus d’énergie !… « S’il avait, au moins, entouré de son âme le sein innocent d’une vierge. Elle aurait été plus digne de lui et la dégradation aurait été moins grande. Il embrasse, avec ses lèvres, ce front couvert de boue, sur lequel les hommes ont marché avec le talon, plein de poussière !… Il aspire, avec des narines effrontées, les émanations de ces deux aisselles humides !… J’ai vu la membrane des dernières se contracter de honte, pendant que, de leur côté, les narines se refusaient à cette respiration infâme. Mais lui, ni elle, ne faisaient aucune attention aux avertissements solennels des aisselles, à la répulsion morne et blême des narines. Elle levait davantage ses bras, et lui, avec une poussée plus forte, enfonçait son visage dans leur creux. J’étais obligé d’être le complice de cette profanation. J’étais obligé d’être le spectateur de ce déhanchement inouï ; d’assister à l’alliage forcé de ces deux êtres, dont un abîme incommensurable séparait les natures diverses» Et je me demandais qui pouvait être son maître ! Et mon œil se recollait à la grille avec plus d’énergie !… « Quand il fut rassasié de respirer cette femme, il voulut lui arracher ses muscles un par un ; mais, comme c’était une femme, il lui pardonna et préféra faire souffrir un être de son sexe. Il appela, dans la cellule voisine, un jeune homme qui était venu dans cette maison pour passer quelques moments d’insouciance avec une de ces femmes, et lui enjoignit de venir se placer à un pas de ses yeux. Il y avait longtemps que je gisais sur le sol. N’ayant pas la force de me lever sur ma racine brûlante, je ne pus voir ce qu’ils firent. Ce que je sais, c’est qu’à peine le jeune homme fut à portée de sa main, que des lambeaux de chair tombèrent aux pieds du lit et vinrent se placer à mes côtés. Ils me racontaient tout bas que les griffes de mon maître les avaient détachés des épaules de l’adolescent. Celui-ci, au bout de quelques heures, pendant lesquelles il avait lutté contre une force plus grande, se leva du lit et se retira majestueusement. Il était littéralement écorché des pieds jusqu’à la tête ; il traînait, à travers les dalles de la chambre, sa peau retournée. Il se disait que son caractère était plein de bonté ; qu’il aimait à croire ses semblables bons aussi ; que pour cela il avait acquiescé au souhait de l’étranger distingué qui l’avait appelé auprès de lui ; mais que, jamais, au grand jamais, il ne se serait attendu à être torturé par un bourreau. Par un pareil bourreau, ajoutait-il après une pause. Enfin, il se dirigea vers le guichet, qui se fendit avec pitié jusqu’au nivellement du sol, en présence de ce corps dépourvu d’épiderme. Sans abandonner sa peau, qui pouvait encore lui servir, ne serait-ce que comme manteau, il essaya de disparaître de ce coupe-gorge ; une fois éloigné de la chambre, je ne pus voir s’il avait eu la force de regagner la porte de sortie. Oh ! comme les poules et les coqs s’éloignaient avec respect, malgré leur faim, de cette longue traînée de sang, sur la terre imbibée ! » Et je me demandais qui pouvait être son maître ! Et mes yeux se recollaient à la grille avec plus d’énergie !… « Alors, celui qui aurait dû penser davantage à sa dignité et à sa justice, se releva, péniblement, sur son coude fatigué. Seul, sombre, dégoûté et hideux !… Il s’habilla lentement. Les nonnes, ensevelies depuis des siècles dans les catacombes du couvent, après avoir été réveillées en sursaut par les bruits de cette nuit horrible, qui s’entre-choquaient entre eux dans une cellule située au-dessus des caveaux, se prirent par la main, et vinrent former une ronde funèbre autour de lui. Pendant qu’il recherchait les décombres de son ancienne splendeur ; qu’il lavait ses mains avec du crachat en les essuyant ensuite sur ses cheveux (il valait mieux les laver avec du crachat, que de ne pas les laver du tout, après le temps d’une nuit entière passée dans le vice et le crime), elles entonnèrent les prières lamentables pour les morts, quand quelqu’un est descendu dans la tombe. En effet, le jeune homme ne devait pas survivre à ce supplice, exercé sur lui par une main divine, et ses agonies se terminèrent pendant les chants des nonnes… » Je me rappelai l’inscription du pilier ; je compris ce qu’était devenu le rêveur pubère que ses amis attendaient encore chaque jour depuis le moment de sa disparition… Et je me demandais qui pouvait être son maître ! Et mes yeux se recollaient à la grille avec plus d’énergie !… « Les murailles s’écartèrent pour le laisser passer ; les nonnes, le voyant prendre son essor, dans les airs, avec des ailes qu’il avait cachées jusque-là dans sa robe d’émeraude, se replacèrent en silence dessous le couvercle de la tombe. Il est parti dans sa demeure céleste, en me laissant ici ; cela n’est pas juste. Les autres cheveux sont restés sur sa tête ; et, moi, je gis, dans cette chambre lugubre, sur le parquet couvert de sang caillé, de lambeaux de viande sèche ; cette chambre est devenue damnée, depuis qu’il s’y est introduit ; personne n’y entre ; cependant, j’y suis enfermé. C’en est donc fait ! Je ne verrai plus les légions des anges marcher en phalanges épaisses, ni les astres se promener dans les jardins de l’harmonie. Eh bien, soit… je saurai supporter mon malheur avec résignation. Mais, je ne manquerai pas de dire aux hommes ce qui s’est passé dans cette cellule. Je leur donnerai la permission de rejeter leur dignité, comme un vêtement inutile, puisqu’ils ont l’exemple de mon maître ; je leur conseillerai de sucer la verge du crime, puisqu’un autre l’a déjà fait… » Le cheveu se tut… Et je me demandais qui pouvait être son maître ! Et mes yeux se recollaient à la grille avec plus d’énergie !… Aussitôt le tonnerre éclata ; une lueur phosphorique pénétra dans la chambre. Je reculai, malgré moi, par je ne sais quel instinct d’avertissement ; quoique je fusse éloigné du guichet, j’entendis une autre voix, mais, celle-ci rampante et douce, de crainte de se faire entendre : « Ne fais pas de pareils bonds ! Tais-toi… tais-toi… si quelqu’un t’entendait ! je te replacerai parmi les autres cheveux ; mais, laisse d’abord le soleil se coucher à l’horizon, afin que la nuit couvre tes pas… je ne t’ai pas oublié ; mais, on t’aurait vu sortir, et j’aurais été compromis. Oh ! si tu savais comme j’ai souffert depuis ce moment ! Revenu au ciel, mes archanges m’ont entouré avec curiosité ; ils n’ont pas voulu me demander le motif de mon absence. Eux, qui n’avaient jamais osé élever leur vue sur moi, jetaient, s’efforçant de deviner l’énigme, des regards stupéfaits sur ma face abattue, quoiqu’ils n’aperçussent pas le fond de ce mystère, et se communiquaient tout bas des pensées qui redoutaient en moi quelque changement inaccoutumé. Ils pleuraient des larmes silencieuses ; ils sentaient vaguement que je n’étais plus le même, devenu inférieur à mon identité. Ils auraient voulu connaître quelle funeste résolution m’avait fait franchir les frontières du ciel, pour venir m’abattre sur la terre, et goûter des voluptés éphémères, qu’eux-mêmes méprisent profondément. Ils remarquèrent sur mon front une goutte de sperme, une goutte de sang. La première avait jailli des cuisses de la courtisane ! La deuxième s’était élancée des veines du martyr ! Stygmates odieux ! Rosaces inébranlables ! Mes archanges ont retrouvé, pendus aux halliers de l’espace, les débris flamboyants de ma tunique d’opale, qui flottaient sur les peuples béants. Ils n’ont pas pu la reconstruire, et mon corps reste nu devant leur innocence ; châtiment mémorable de la vertu abandonnée. Vois les sillons qui se sont tracé un lit sur mes joues décolorées : c’est la goutte de sperme et la goutte de sang, qui filtrent lentement le long de mes rides sèches. Arrivées à la lèvre supérieure, elles font un effort immense, et pénètrent dans le sanctuaire de ma bouche, attirées, comme un aimant, par le gosier irrésistible. Elles m’étouffent, ces deux gouttes implacables. Moi, jusqu’ici, je m’étais cru le Tout-Puissant ; mais, non ; je dois abaisser le cou devant le remords qui me crie : « Tu n’es qu’un misérable ! » Ne fais pas de pareils bonds ! Tais-toi… tais-toi… si quelqu’un t’entendait ! je te replacerai parmi les autres cheveux ; mais, laisse d’abord le soleil se coucher à l’horizon, afin que la nuit couvre tes pas… J’ai vu Satan, le grand ennemi, redresser les enchevêtrements osseux de la charpente, au-dessus de son engourdissement de larve, et, debout, triomphant, sublime, haranguer ses troupes rassemblées ; comme je le mérite, me tourner en dérision. Il a dit qu’il s’étonnait beaucoup que son orgueilleux rival, pris en flagrant délit par le succès, enfin réalisé, d’un espionnage perpétuel, pût ainsi s’abaisser jusqu’à baiser la robe de la débauche humaine, par un voyage de long cours à travers les récifs de l’éther, et faire périr, dans les souffrances, un membre de l’humanité. Il a dit que ce jeune homme, broyé dans l’engrenage de mes supplices raffinés, aurait peut-être pu devenir une intelligence de génie ; consoler les hommes, sur cette terre, par des chants admirables de poésie, de courage, contre les coups de l’infortune. Il a dit que les nonnes du couvent-lupanar ne retrouvent plus leur sommeil ; rôdent dans le préau, gesticulant comme des automates, écrasant avec le pied les renoncules et les lilas ; devenues folles d’indignation, mais, non assez, pour ne pas se rappeler la cause qui engendra cette maladie, dans leur cerveau… (Les voici qui s’avancent, revêtues de leur linceul blanc ; elle ne se parlent pas ; elle se tiennent par la main. Leurs cheveux tombent en désordre sur leurs épaules nues ; un bouquet de fleurs noires est penché sur leur sein. Nonnes, retournez dans vos caveaux ; la nuit n’est pas encore complètement arrivée ; ce n’est que le crépuscule du soir… O cheveu, tu le vois toi-même ; de tous les côtés, je suis assailli par le sentiment déchaîné de ma dépravation !) Il a dit que le Créateur, qui se vante d’être la Providence de tout ce qui existe, s’est conduit avec beaucoup de légèreté, pour ne pas dire plus, en offrant un pareil spectacle aux mondes étoilés ; car, il a affirmé clairement le dessein qu’il avait d’aller rapporter dans les planètes orbiculaires comment je maintiens, par mon propre exemple, la vertu et la bonté dans la vastitude de mes royaumes. Il a dit que la grande estime, qu’il avait pour un ennemi si noble, s’était envolée de son imagination, et qu’il préférait porter la main sur le sein d’une jeune fille, quoique cela soit un acte de méchanceté exécrable, que de cracher sur ma figure, recouverte de trois couches de sang et de sperme mêlés, afin de ne pas salir son crachat baveux. Il a dit qu’il se croyait, à juste titre, supérieur à moi, non par le vice, mais par la vertu et la pudeur ; non par le crime, mais par la justice. Il a dit qu’il fallait m’attacher à une claie, à cause de mes fautes innombrables ; me faire brûler à petit feu dans un brasier ardent, pour me jeter ensuite dans la mer, si toutefois la mer voudrait me recevoir. Que puisque je me vantais d’être juste, moi, qui l’avais condamné au peines éternelles pour une révolte légère qui n’avait pas eu de suites graves, je devais donc faire justice sévère sur moi-même, et juger impartialement ma conscience, chargée d’iniquités… Ne fais pas de pareils bonds ! Tais-toi… tais-toi… si quelqu’un t’entendait ! je te replacerai parmi les autres cheveux ; mais, laisse d’abord le soleil se coucher à l’horizon, afin que la nuit couvre tes pas. » Il s’arrêta un instant ; quoique je ne le visse point, je compris, par ce temps d’arrêt nécessaire, que la houle de l’émotion soulevait sa poitrine, comme un cyclone giratoire soulève une famille de baleines. Poitrine divine, souillée, un jour, par l’amer contact des têtons d’une femme sans pudeur ! Âme royale, livrée, dans un moment d’oubli, au crabe de la débauche, au poulpe de la faiblesse de caractère, au requin de l’abjection individuelle, au boa de la morale absente, et au colimaçon monstrueux de l’idiotisme ! Le cheveu et son maître s’embrassèrent étroitement, comme deux amis qui se revoient après une longue absence. Le Créateur continua, accusé reparaissant devant son propre tribunal : Et les hommes, que penseront-ils de moi, dont ils avaient une opinion si élevée, quand ils apprendront les errements de ma conduite, la marche hésitante de ma sandale, dans les labyrinthes boueux de la matière, et la direction de ma route ténébreuse à travers les eaux stagnantes et les humides joncs de la mare où, recouvert de brouillards, bleuit et mugit le crime, à la patte sombre !… Je m’aperçois qu’il faut que je travaille beaucoup à ma réhabilitation, dans l’avenir, afin de reconquérir leur estime. Je suis le Grand-Tout ; et cependant, par un côté, je reste inférieur aux hommes, que j’ai créés avec un peu de sable ! Raconte-leur un mensonge audacieux, et dis-leur que je ne suis jamais sorti du ciel, constamment enfermé, avec les soucis du trône, entre les marbres, les statues et les mosaïques de mes palais. Je me suis présenté devant les célestes fils de l’humanité ; je leur ai dit : « Chassez le mal de vos chaumières, et laissez entrer au foyer le manteau du bien. Celui-ci qui portera la main sur un de ses semblables, en lui faisant au sein une blessure mortelle, avec le fer homicide, qu’il n’espère point les effets de ma miséricorde, et qu’il redoute les balances de la justice. Il ira cacher sa tristesse dans les bois ; mais, le bruissement des feuilles, à travers les clairières, chantera à ses oreilles la ballade du remords ; et il s’enfuira de ces parages, piqué à la hanche par le buisson, le houx et le chardon bleu, ses pas rapides entrelacés par la souplesse des lianes et les morsures des scorpions. Il se dirigera vers les galets de la plage ; mais, la marée montante, avec ses embruns et son approche dangereuse, lui raconteront qu’ils n’ignorent pas son passé ; et il précipitera sa course aveugle vers le couronnement de la falaise, tandis que les vents stridents d’équinoxe, en s’enfonçant dans les grottes naturelles du golfe et les carrières pratiquées sous la muraille des rochers retentissants, beugleront comme les troupeaux immenses des buffles des pampas. Les phares de la côte le poursuivront, jusqu’aux limites du septentrion, de leurs reflets sarcastiques, et les feux follets des maremmes, simples vapeurs en combustion, dans leurs danses fantastiques, feront frissonner les poils de ses pores, et verdir l’iris de ses yeux. Que la pudeur se plaise dans vos cabanes, et soit en sûreté à l’ombre de vos champs. C’est ainsi que vos fils deviendront beaux, et s’inclineront devant leurs parents avec reconnaissance ; sinon, malingres, et rabougris comme le parchemin des bibliothèques, ils s’avanceront à grands pas, conduits par la révolte, contre le jour de leur naissance et le clitoris de leur mère impure. » Comment les hommes voudront-ils obéir à ces lois sévères, si le législateur lui-même se refuse le premier à s’y astreindre ?… Et ma honte est immense comme l’éternité ! » J’entendis le cheveu qui lui pardonnait, avec humilité, sa séquestration, puisque son maître avait agi par prudence et non par légèreté ; et le pâle dernier rayon de soleil qui éclairait mes paupières se retira des ravins de la montagne. Tourné vers lui, je le vis se replier ainsi qu’un linceul… Ne fais pas de pareils bonds ! Tais-toi… tais-toi… si quelqu’un t’entendait ! Il te replacera parmi les autres cheveux. Et, maintenant que le soleil est couché à l’horizon, vieillard cynique et cheveu doux, rampez, tous les deux, vers l’éloignement du lupanar, pendant que la nuit, étendant son ombre sur le couvent, couvre l’allongement de vos pas furtifs dans la plaine… Alors, le pou, sortant subitement de derrière un promontoire, me dit, en hérissant ses griffes : « Que penses-tu de cela ? » Mais, moi, je ne voulus pas lui répliquer. Je me retirai, et j’arrivai sur le pont. J’effaçai l’inscription primordiale, je la remplaçai par celle-ci : « Il est douloureux de garder, comme un poignard, un tel secret dans son cœur ; mais, je jure de ne jamais révéler ce dont j’ai été témoin, quand je pénétrai, pour la première fois, dans ce donjon terrible. » Je jetai, par dessus le parapet, le canif qui m’avait servi à graver les lettres ; et, faisant quelques rapides réflexions sur le caractère du Créateur en enfance, qui devait encore, hélas ! pendant bien de temps, faire souffrir l’humanité (l’éternité est longue), soit par les cruautés exercées, soit par le spectacle ignoble des chancres qu’occasionne un grand vice, je fermai les yeux, comme un homme ivre, à la pensée d’avoir un tel être pour ennemi, et je repris, avec tristesse, mon chemin, à travers les dédales des rues.
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne.
Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne
Ne sont jamais allés à l’école une fois,
Et ne savent pas lire, et signent d’une croix.
C’est dans cette ombre-là qu’ils ont trouvé le crime.
L’ignorance est la nuit qui commence l’abîme.
Où rampe la raison, l’honnêteté périt.
Dieu, le premier auteur de tout ce qu’on écrit,
A mis, sur cette terre où les hommes sont ivres,
Les ailes des esprits dans les pages des livres.
Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, et peut
Planer là-haut où l’âme en liberté se meut.
L’école est sanctuaire autant que la chapelle.
L’alphabet que l’enfant avec son doigt épelle
Contient sous chaque lettre une vertu ; le cœur
S’éclaire doucement à cette humble lueur.
Donc au petit enfant donnez le petit livre.
Marchez, la lampe en main, pour qu’il puisse vous suivre.
La nuit produit l’erreur et l’erreur l’attentat.
Faute d’enseignement, on jette dans l’état
Des hommes animaux, têtes inachevées,
Tristes instincts qui vont les prunelles crevées,
Aveugles effrayants, au regard sépulcral,
Qui marchent à tâtons dans le monde moral.
Allumons les esprits, c’est notre loi première,
Et du suif le plus vil faisons une lumière.
L’intelligence veut être ouverte ici-bas ;
Le germe a droit d’éclore ; et qui ne pense pas
Ne vit pas. Ces voleurs avaient le droit de vivre.
Songeons-y bien, l’école en or change le cuivre,
Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or.
Je dis que ces voleurs possédaient un trésor,
Leur pensée immortelle, auguste et nécessaire ;
Je dis qu’ils ont le droit, du fond de leur misère,
De se tourner vers vous, à qui le jour sourit,
Et de vous demander compte de leur esprit ;
Je dis qu’ils étaient l’homme et qu’on en fit la brute ;
Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute ;
Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés ;
Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés
Ont pour point de départ ce qui n’est pas leur faute ;
Pouvaient-ils s’éclairer du flambeau qu’on leur ôte ?
Ils sont les malheureux et non les ennemis.
Le premier crime fut sur eux-mêmes commis ;
On a de la pensée éteint en eux la flamme ;
Et la société leur a volé leur âme. »
Victor Hugo, Jersey, 27 février 1853, Les Quatre vents de l’Esprit.
Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne
Ne sont jamais allés à l’école une fois,
Et ne savent pas lire, et signent d’une croix.
C’est dans cette ombre-là qu’ils ont trouvé le crime.
L’ignorance est la nuit qui commence l’abîme.
Où rampe la raison, l’honnêteté périt.
Dieu, le premier auteur de tout ce qu’on écrit,
A mis, sur cette terre où les hommes sont ivres,
Les ailes des esprits dans les pages des livres.
Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, et peut
Planer là-haut où l’âme en liberté se meut.
L’école est sanctuaire autant que la chapelle.
L’alphabet que l’enfant avec son doigt épelle
Contient sous chaque lettre une vertu ; le cœur
S’éclaire doucement à cette humble lueur.
Donc au petit enfant donnez le petit livre.
Marchez, la lampe en main, pour qu’il puisse vous suivre.
La nuit produit l’erreur et l’erreur l’attentat.
Faute d’enseignement, on jette dans l’état
Des hommes animaux, têtes inachevées,
Tristes instincts qui vont les prunelles crevées,
Aveugles effrayants, au regard sépulcral,
Qui marchent à tâtons dans le monde moral.
Allumons les esprits, c’est notre loi première,
Et du suif le plus vil faisons une lumière.
L’intelligence veut être ouverte ici-bas ;
Le germe a droit d’éclore ; et qui ne pense pas
Ne vit pas. Ces voleurs avaient le droit de vivre.
Songeons-y bien, l’école en or change le cuivre,
Tandis que l’ignorance en plomb transforme l’or.
Je dis que ces voleurs possédaient un trésor,
Leur pensée immortelle, auguste et nécessaire ;
Je dis qu’ils ont le droit, du fond de leur misère,
De se tourner vers vous, à qui le jour sourit,
Et de vous demander compte de leur esprit ;
Je dis qu’ils étaient l’homme et qu’on en fit la brute ;
Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute ;
Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés ;
Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés
Ont pour point de départ ce qui n’est pas leur faute ;
Pouvaient-ils s’éclairer du flambeau qu’on leur ôte ?
Ils sont les malheureux et non les ennemis.
Le premier crime fut sur eux-mêmes commis ;
On a de la pensée éteint en eux la flamme ;
Et la société leur a volé leur âme. »
Victor Hugo, Jersey, 27 février 1853, Les Quatre vents de l’Esprit.

Kodiak- Messages : 1904
Date d'inscription : 05/11/2013
Age : 61
Localisation : Nice
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
La Fin de Tristan Corbière, réponse acide à Oceano nox de Victor Hugo (Ô combien de marins, combien de capitaines) :
Eh bien, tous ces marins - matelots, capitaines,
Dans leur grand Océan à jamais engloutis...
Partis insoucieux pour leurs courses lointaines
Sont morts - absolument comme ils étaient partis.
Allons! c'est leur métier ; ils sont morts dans leurs bottes !
Leur boujaron au cœur, tout vifs dans leurs capotes...
- Morts... Merci : la Camarde a pas le pied marin ;
Qu'elle couche avec vous : c'est votre bonne femme...
- Eux, allons donc : Entiers! enlevés par la lame
Ou perdus dans un grain...
Un grain... est-ce la mort ça ? la basse voilure
Battant à travers l'eau ! - Ça se dit encombrer...
Un coup de mer plombe, puis la haute mâture
Fouettant les flots ras - et ça se dit sombrer.
- Sombrer - Sondez ce mot. Votre mort est bien pâle
Et pas grand'chose à bord, sous la lourde rafale...
Pas grand'chose devant le grand sourire amer
Du matelot qui lutte. - Allons donc, de la place ! -
Vieux fantôme éventé, la Mort change de face :
La Mer !...
Noyés ? - Eh allons donc ! Les noyés sont d'eau douce.
- Coulés ! corps et biens ! Et, jusqu'au petit mousse,
Le défi dans les yeux, dans les dents le juron !
À l'écume crachant une chique râlée,
Buvant sans hauts-de-coeur la grand'tasse salée...
- Comme ils ont bu leur boujaron. -
- Pas de fond de six pieds, ni rats de cimetière :
Eux ils vont aux requins ! L'âme d'un matelot
Au lieu de suinter dans vos pommes de terre,
Respire à chaque flot.
- Voyez à l'horizon se soulever la houle ;
On dirait le ventre amoureux
D'une fille de joie en rut, à moitié soûle...
Ils sont là ! - La houle a du creux. -
- Ecoutez, écoutez la tourmente qui meugle !…
C’est leur anniversaire – Il revient bien souvent –
Ô poète, gardez pour vous vos chants d’aveugle ;
- Eux : le De profundis que leur corne le vent.
.. Qu’ils roulent infinis dans les espaces vierges !…
Qu’ils roulent verts et nus,
Sans clous et sans sapin, sans couvercle, sans cierges…
- Laissez-les donc rouler, terriens parvenus !
À bord. – 11 février.
Invité- Invité
 Re: Vos poèmes préférés
Re: Vos poèmes préférés
- Autre baiser
Quand ton col de couleur de rose
Se donne à mon embrassement,
Et ton œil languist doulcement
D'une paupiere à demy close,
Mon ame se fond du desir
Dont elle est ardentement pleine,
Et ne peult souffrir à grand'peine
La force d'un si grand plaisir.
Puis quand j'approche de la tienne
Ma levre, et que si pres je suis,
Que la fleur recuillir je puis
De ton haleine Ambrosienne :
Quand le souspir de ces odeurs,
Ou noz deux langues qui se jouënt
Moitement folastrent et nouënt,
Evente nos doulces ardeurs,
Il me semble estre assis à table
Avec les Dieux, tant suis heureux,
Et boire à longs traicts savoureux
Leur doulx breuvage delectable.
Si le bien qui au plus grand bien
Est plus prochain, prendre on me laisse,
Pourquoy ne permets‑tu, maistresse,
Qu'encores le plus grand soit mien ?
As‑tu peur que la jouissance
D'un si grand heur me face Dieu,
Et que sans toy je vole au lieu
D'eternelle resjouissance ?
Belle, n'aye peur de cela,
Par tout où sera ta demeure,
Mon ciel jusqu'à tant que je meure,
Et mon paradis sera là.
Joachim du Bellay, Jeux rustiques, XXIV
Pieyre- Messages : 20908
Date d'inscription : 17/03/2012
Localisation : Quartier Latin
Page 4 sur 9 •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 Sujets similaires
Sujets similaires» Vos passages préférés de poèmes
» Partageons nos blogs préférés
» Vos passages de livre préférés
» Vos poètes contemporains préférés
» mes bestioles préférés :)
» Partageons nos blogs préférés
» Vos passages de livre préférés
» Vos poètes contemporains préférés
» mes bestioles préférés :)
Page 4 sur 9
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 Évènements
Évènements